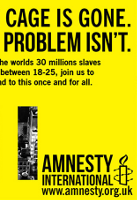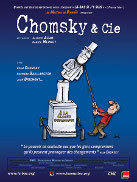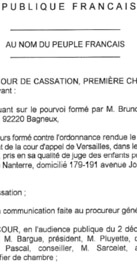| « La fonctionnaire a « appliqué la loi de bonne foi » | Qui décide des programmes d'histoire-géographie ? » |
« Seule la loi pourra moraliser le capitalisme »
«Seule la loi pourra moraliser le capitalisme»
INTERVIEW. Philosophe matérialiste et humaniste, intellectuel de gauche, André Comte-Sponville défend l'amoralité de l'économie. Selon lui, la crise montre que ce n'est pas l'intérêt qui guide les marchés, mais la passion.
Mercredi 29 octobre 2008 18:10, LeTemps.ch, extrait
LeTemps.ch: Etes-vous toujours aussi certain, comme vous l'affirmez dans votre livre, que le capitalisme moderne n'est ni moral ni immoral, mais amoral?
André Comte-Sponville: Il n'y a de morale ou d'immoralité que par les individus. Le capitalisme n'étant pas un individu, la question paraît réglée de façon quasi métaphysique. Cette crise ne fait que de montrer que les individus sont prêts à toutes les folies par appât du gain. Le capitalisme ne fonctionne ni à la vertu ni au désintéressement; il fonctionne à l'égoïsme. Cela conforte la thèse que j'avance dans mon livre, selon laquelle le capitalisme a besoin de limites externes, de limites non marchandes, qui ne peuvent venir que de la politique et du droit. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il veut «moraliser le capitalisme», je ne suis pas contre l'idée. Mais s'il dit par là qu'il veut rendre les banquiers davantage moraux, c'est une pure et simple illusion! Il est important de comprendre que quand on parle de «moraliser le capitalisme», ce n'est pas de la morale qu'il faut ajouter, mais de la loi. C'est du droit, et donc de la contrainte. On parle donc d'un retour à la morale, mais ce à quoi on assiste véritablement, c'est à d'un retour à l'Etat. De ce point de vue, il n'est pas impossible que cette crise ait des effets positifs.
– Selon la règle, celui qui échoue fait faillite. Or il a été admis que plus aucune banque ne pourrait faire faillite, que cela ferait courir un trop grand danger à l'ensemble du système. La capitalisme s'est-il renié?
– Il y a effectivement un certain nombre d'entreprises, dont font partie les banques, qui sont devenues trop importantes pour l'économie pour qu'on puisse accepter qu'elle fassent faillite. Cela confirme que l'attitude prise par les politiques n'est pas fondée sur la morale. Hank Paulson [le secrétaire au trésor auteur du plan de sauvetage américain] a dit qu'il détestait ces mesures, parce que justement il sauvait des banquiers pour lesquels il n'avait pas spécialement d'estime. Ce n'est donc pas la morale qui vient guider la politique économique. On préférerait que ces banquiers soient ruinés – on s'en fiche d'ailleurs si ils le sont individuellement – mais on ne peut pas l'accepter collectivement. Parce que les répercutions économiques seraient si graves qu'elles mettraient le système en danger. La morale ne guide pas l'économie, elle ne la régule pas non plus, et ce n'est même pas elle qui gouverne la politique économique. Le problème n'est pas de donner des bons ou des mauvais points, en disant que ceux qui ont pêché doivent être punis. Le problème et de savoir comment sauver l'économie.
– Pourtant la cupidité est immorale, et même source d'inefficacité sur le marché.
– C'est vrai, mais ce sont les individus qui sont cupides, pas le capitalisme. En outre, il est un peu facile de condamner la cupidité des autres. On s'étonne que les banquiers n'aient pas limité d'eux-même leurs propres salaires. J'aimerais qu'on me présente un salarié qui un jour a refusé une augmentation.
– On ne leur aurait pas reproché leurs salaires si leur cupidité ne les avait pas mené à l'échec!
– Pour le coup, Nicolas Sarkozy avait raison quand il dénonçait les parachutes dorés. Il les décrivait comme un gain sans risque. Or l'esprit du capitalisme est justement que les gains doivent être proportionnels aux risques. Il y a quelque chose qui n'est fidèle ni à la morale ni au capitalisme dans cette notion d'absence de risques et de gains assurés. Comment l'empêcher? Sûrement pas en comptant sur la conscience morales des patrons. La seule solution vient de la politique et du droit qui fixeront des limites externes à l'enrichissement des uns et des autres. Les ultralibéraux se trompaient quand il disaient que les règles internes du marché suffiraient pour éviter le pire. Alan Greenspan l'a reconnu, de façon assez émouvante, en admettant lui-même s'être trompé. Il pensait que les banquiers avaient suffisamment conscience de leurs propre intérêt pour ne pas faire ces bêtises-là.Cela prouve simplement que ce n'est pas le seul intérêt qui motive les gens. Si c'était le cas, on pourrait avoir confiance! L'intérêt pousse à l'intelligence. Le drame est que les gens ne sont pas mus par l'intérêt mais par la passion. Or la passion est aveugle et déraisonnable. Greenspan a eu tort parce que ce qui a guidé les banquiers n'était pas l'intérêt intelligent, c'était une passion aveugle et déraisonnable: la cupidité. Ce qui est autre chose que l'intérêt, puisque par cupidité, certains se sont ruinés. Cela signifie que la logique profonde du marché est complètement rationnelle, et en même temps complètement déraisonnable. Il est important de faire la différence entre ce qui est rationnel – ce que la raison peut comprendre – et ce qui est raisonnable, c'est à dire ce que la raison peut approuver. Par exemple, la folie est rationnelle. Si elle ne l'était pas, la psychiatrie serait impossible. La psychiatrie permet de comprendre les causes rationnelles d'un attitude déraisonnable. Pareil pour le marché; c'est ce que les physiciens appelleraient un système chaotique, totalement déterminé, totalement rationnel, et pourtant totalement imprévisible.De même qu'avec la météo, le temps qu'il fait n'est jamais irrationnel. Il a ses causes, il a sa rationalité, mais il est parfaitement imprévisible huit jours à l'avance. Tout comme la bourse. Si les acteurs du marché ne sont pas rationnels mais se contentent de suivre leurs passions folles, il devient donc indispensable de fixer des limites. C'est ce qu'on appelle le droit: des limites imposées à la liberté des individus.
– S'il faut des limites, c'est qu'il existe un forme d'immoralité à corriger.
– Encore une fois, la cupidité vient des individus. Or le paradoxe est que nous sommes moins aveuglément égoïstes en tant que citoyen que nous le sommes en tant qu'individu. Permettez-moi un exemple automobile. Je suis père de famille, et je ne m'intéresse ni aux voitures ni à la vitesse. Mais comme tout le monde, j'ai eu tendance à rouler trop vite. J'ai lu Spinoza, Kant et aimé Marx, mais la vérité est celle-là: les plus grands philosophes au monde n'ont pas réussi à me faire lever le pied. Trois petits radars, trois petits PV, trois petits points en moins sur mon permis ont été plus efficaces que la lecture des plus grands auteurs. Terrible leçon d'humilité! Pourtant, le citoyen que je suis a voté – indirectement – pour ces lois strictes sur la circulation routière. Il s'est dit qu'elles allaient le protéger contre les chauffards. Autrement dit, le citoyen que je suis est plus raisonnable en matière de circulation routière que le conducteur. Ce n'est qu'une analogie, mais je crois que c'est vrai aussi en économie. Les citoyens que nous sommes sont plus raisonnables en matière de politique économique que les consommateurs, les investisseurs ou les actionnaires, selon les cas, que nous sommes aussi. Il nous faut donc jouer sur cette intelligence collective que seule la politique nous permet.
– Dans votre livre, vous décrivez une forme très traditionnelle du capitalisme. S'y affrontent les actionnaires, l'État, les salariés. Les choses n'ont-elle pas changé à l'heure de la finance? Par exemple, les managers qui parviennent à se faire verser des bonus considérables ne sont-il pas une nouvelle classe de super-salariés?
– Le capitalisme est au service des actionnaires et je ne crois pas que cette crise y change quoi que ce soit. En vérité, c'est parce qu'ils attendaient un gain en retour qu'ils ont signé des contrats parfois léonins à des managers. Ils attendaient une montée en bourse de leurs actions, qui d'ailleurs s'est produite pendant les plusieurs années. Ce que vous suggérez est d'ailleurs le contraire de ce qui se disait au début des années 2000. A l'époque des gens comme Alain Minc – et cela faisait l'objet d'une espèce de consensus – disaient qu'on avait assisté à un capitalisme managérial dans les années 60 et 70 qui s'est transformé en un capitalisme patrimonial dans les années 90 et 2000. Autrement dit, la grande nouvelle des années 2000, c'était précisément que les actionnaires reprenaient le pouvoir.Aujourd'hui, je pense que le capitalisme est encore un peu plus au service des actionnaires et un peu moins au service des managers. Si des ceux-ci sont pris trop de pouvoir, c'est parce que les actionnaires ont cru que c'était dans leur intérêt.
– Une autre différence: le capitalisme classique, par définition, sert à produire de la richesse avec de la richesse. Or dans le cas présent, le jeu consistait à faire de la richesse avec de la dette. N'est-ce pas une différence fondamentale?
– On touche là du doigt la singularité de cette crise. S'enrichir avec de l'argent qu'on possède, c'est le capital, la «richesse créatrice de richesse». S'enrichir avec de l'argent qu'on ne possède pas, c'est peut-être la vraie nouveauté de ce capitalisme-là. Nous le constatons aujourd'hui: le capitalisme financier, quand il devient un capitalisme de la dette, devient mortifère. Je peux imaginer qu'un certain nombre des mesures qui vont être prises dans les années qui viennent interdiront de pousser ce jeu trop loin. Tout en rappelant que la dette n'est ni immorale ni absurde. C'est une question de mesure. Ce qui m'amuse justement, c'est que l'idée de prêter aux pauvres n'était pas une si mauvaise idée! Mon ami Luc Ferry avec qui je déjeunais l'autre jour me disait: sait-on combien de pauvres américains ont pu acheter leur maison grâce aux subprime? On sait combien ont dû vendre leur maison, mais combien on pu l'acheter et la garderont? Tant que nous n'aurons pas ces chiffres, l'appréciation globale restera discutable. Prêter aux pauvre et titriser ces dettes pour disperser le risque pouvait passer pour une bonne idée. Le risque s'est avéré catastrophique.
– Vous mentionniez Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous de son action?
– Je n'ai pas voté pour lui, mais je n'ai ni haine ni mépris. Mes amis de gauche ont tendance à le traiter un peu facilement de débile ou de fasciste, alors que d'évidence, il n'est ni l'un ni l'autre. J'avais apprécié sa campagne mais j'ai été déçu par sa prise de pouvoir, à la fois par la vulgarité du personnage, mais aussi par sa politique économique. Il affichait par exemple fièrement son «volontarisme», selon ses propres termes, en disant qu'il irait «chercher la croissance avec les dents». Or à mon sens, le volontarisme est un défaut. C'est demander à la volonté des choses que la volonté ne peut pas obtenir. Ce n'est pas parce qu'on veut très fort la croissance qu'on l'aura! C'est n'avoir rien compris aux problèmes de l'économie. En réalité, ce discours est angélique. Cela revient à demander à la politique de régenter des phénomènes qui sont par définition en dehors de son contrôle. Certes, la politique est là pour limiter un certain nombre de phénomènes qui ont cours au sein de l'économie, mais pour les limiter de l'extérieur, pas pour les régenter de l'intérieur. La loi de l'offre et de la demande continuera toujours de ne pas obéir à l'Etat, justement parce que c'est une loi économique. On peut par exemple imposer des limites aux salaires, dont la fixation découle de l'offre et de la demande, en établissant un plancher minimum. Cela s'appelle le SMIC en France, qui est une limite non marchande au marché du travail. On pourrait tout aussi bien lui fixer une limite supérieure. Mais entre ces deux extrêmes, on ne va pas demander à l'Etat de fixer les salaires de toutes les corporations. Pareil pour la croissance! L'Etat est à sa place quand il pose des limites sur l'utilisation des crédits, mais il ne pourra pas gouverner le marché de l'intérieur. Je soupçonne que Sarkozy, porté par la crise, exalté par tempérament, gratifié par le fait d'être président de l'Europe, retombe dans son vieux démon qui est précisément un volontarisme voué à l'échec. L'économie a parfois besoin de volonté, elle a surtout besoin d'intelligence. Il ne suffit pas de vouloir.