August 23, 2007
L'« enquête » sur ces faits se limita à un petit mot d'explication
Les références d'un ouvrage de Vladimir Boukovsky qui dépeint assez bien ce que peut être une « maison d'enfant » et des usages au sein du dispositif de la protection de l'enfance.Evidemment, ce ne sont pas les surveillants qui tabassent les enfants, ce sont les plus grands, les jeunes majeurs, qui tabassent les petits, lorsque les éducateurs (ou les stagiaires) ont le dos tourné.
Dans un tel dispositif, l'enfant a le choix : accepter le placement en famille d'accueil ou rester à l'internat.
Plaignez vous auprès des instances compétentes et vous vous appercevrez qu'un petit mot d'explication émanent de la « maison d'enfant » suffira pour faire classer l'affaire. Insistez et le juge pour enfant suspend tous vos droits puis fait disparaitre l'enfant.
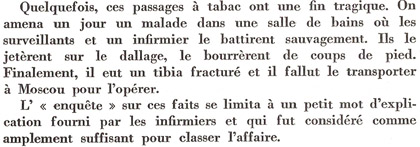
Page 32 : « Si un passage à tabac s'ébruite par trop, les médecins réagissent en déplaçant le malade dans une autre section. (...) Les surveillants, encouragés par une telle tolérance, multiplièrent dès lors leurs exactions contre les malades, se vantant ouvertement de leur impunité. » Page 28 : « Dès l'arrivée d'un détenu politique dans un hôpital spécial, les médecins, lors de la première visite, le placent devant l'alternative suivante : ou renoncer à ses opinions, ou rester interné jusqu'à la fin de ses jours. » Page 34 : « Le système en place est tel que même les personnes qui ont une attitude humaine à l'égard des malades ne peuvent pratiquement leur être d'aucune aide. » Page 36-37 : « Toutes les plaintes et toutes les protestations des malades restent, bien évidemment, lettre morte, si on laisse de côté les mutations des protestataires d'une section à l'autre. (...) Le plus souvent, ce sont les victimes de ces exactions ou ceux qui s'efforcent de les dénoncer et d'en défendre les victimes - et non leurs auteurs - que l'on mute. » Page 37 : « Un tel cas est impossible dans notre hôpital. » Page 38 : « Si l'on arrive par hasard à esquiver tous les obstacles et à faire acheminer les lettres jusqu'aux instances supérieures, ces dernières ne manquent jamais de les retourner à leurs "destinataires", c'est à dire à l'administration de l'hôpital même. Et nous continuons à vivre dans cet "anti-monde" clos, régi par ses "anti-lois". » Page 38 : « Après ce qui vient d'être dit, un problème se pose tout naturellement : celui de la légalité et de l'utilité de ces hopitaux spéciaux. Du point de vue du droit, leur existance est illégale et absurde... du point de vue de l'efficacité thérapeuthique et de l'humanité, jugez vous-même ! » Page 39 : « Enfin, la limitation des visites et de la correspondance non seulement traumatise les malades et mène à la dislocation des familles, mais favorise également l'arbitraire car les parents des malades sont, en règle générale, privés de la possibilité de les défendre de manière organisée. La sélection du contingent des malades (dont la majorité viennent d'autres villes) et l'atmosphère de secret qui entoure l'hôpital ne font que renforcer cet état de choses. » Page 40, « il n'existe point dans notre pays d'instance officielle à laquelle on pourrait recourir » : |

Page 63, « personne, moi pas plus que d'autres, ne peut avoir de garanties contre l'arbitraire », puis, en page 65, « les enquêtes que l'on a ouvertes (...) contre nous sans jamais nous interroger » : |
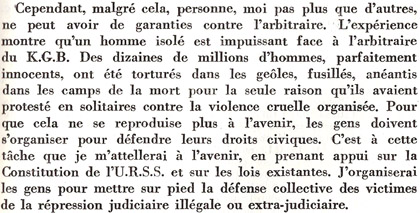
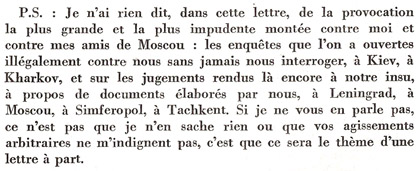
Page 170, « Et comme rien ne permet de m'arrêter, on veut m'effrayer », qui n'est pas sans faire écho à « Sorcières, justice et société », « En un mot "l'idée mère de l'ancienne procédure criminelle était l'intimidation" » : |

La page 171 ne fait que conforter cette impression, « en août 1539 (...) L'instruction du procès, devenue écrite et secrète, se substitue au débat oral et public » : - Nous recevons néamoins des demandes de renseignement. Il y a donc bien une raison qui les poussent à s'adresser à nous. - Dites moi concrètement quelle est cette cause... Alors nous discuterons au fond. - Ils ne nous disent rien de concret. - Eh bien je ne sais pas... Pourquoi donc ne vous renseignez-vous pas auprès d'eux ? Ce serait bien naturel, après tout... - Nous avons tout le temps. Vous avez, quoi qu'il en soit, quelque chose à vous repprocher. (...) Des infirmiers entrent dans le bureau. - Que faites-vous ? Vous allez m'interner dans un hôpital ? - Oui, pas pour longtemps... « Oui, pas pour longtemps... » C'est comme les placements d'enfant dans le secteur de Nanterre : du provisoire qui s'inscrit dans la durée. Page 170 : « Ne pensez pas, surtout, que nous sommes avec le K.G.B. contre vous. Au contraire, notre devoir est d'aider les malades et de les protéger. » En page 76, Piotr Grigorenko verse, lui également, dans le cynisme. Selon ce même ouvrage, de nombreux « malades » souffraient de paranoïa. Extraits du mémoire de recherche présenté par M. Guillaume Nicolas-Brion, IEP Toulouse, 2004, « Un rouage contre la machine ou les combats de Vladimir Boukovski »... « L'histoire de cette création -de l'homme nouveau soviétique-, ses vecteurs et ses instruments sont expliqués par Michel Heller : "la transformation physique et mentale des habitants du nouveau monde s'effectue à l'aide de puissants instruments : la peur, la haine, la corruption. Le `bâton` va de pair avec la `carotte`, des mythes spécialement crées pour servir les buts de l'Etat. [C'est] l'histoire d'une expérience jamais vue." » « [Une] vision (...) vivement contestée dans la communauté scientifique des historiens (...) Car cette volonté totalitaire d'imposer à tous l'idéologie en vigueur est impossible, comme nous l'ont appris les utopies les plus fictives - c'est à dire celles que nous a léguées la littérature et pouvant être rapprochée du système soviétique - ou les apports de l'école révisioniste. Une société où l'Etat arrive à s'imiscer dans chaque branche de la vie des populations ne peut pas exister, c'est un idéal-type selon un terme emprunté à la sociologie de Max Weber il reste toujours certains domaines dans lesquels l'Etat ne peut pas intervenir, même s'il le désire. Il peut s'agir de moments de la vie quotidienne, mais aussi des volontés personnelles de ne pas adhérer à l'idéologie officielle : il se trouvera toujours des personnes pour refuser le régime en place, quelle que soit la force que l'Etat leur oppose. Pour synthétiser et généraliser à l'extrême, tout régime totalitaire, par sa nature même, entraîne des actions de dissidence selon Jean-François Revel. » « C'est la maîtresse d'école qui fait un cours de géographie devant une mappemonde. "Les enfants, ici ce sont les Etats-Unis. Les gens y vivent très mal et comme ils n'ont pas d'argent ils ne peuvent pas acheter de bonbons et de glaces et ne peuvent pas emmener leurs enfants au cinéma. Là, par contre, c'est l'Union soviétique : tous les hommes sont heureux, ils vivent bien, achètent tous les jours des glaces et des bonbons et emmènent les enfants au cinéma." A ce moment là, une petite fille se met à pleurer. La maîtresse l'interpelle et lui demande la raison de ses larmes. La petite fille déclare : "je veux aller en Union soviétiqueé. Racontée à Boukovski enfant, cette histoire crée en lui le "premier malentendu". » « La véritable cause de l'anti-communisme de Boukovski se trouve dans une autre anecdote... » A lire en page 30 et 31... « Comment peut-il être le plus juste et le meilleur système du monde si les relations haut placées peuvent mettre à l'abri celle qui fait pipi dans sa culotte au moment d'un tel privilège -saluer notre bien-aimé leader- ? Ma foi dans le communisme fut gravement anéantie. » « Agir ou non ? Le troisième épisode se situe après l'affaire du complot des blouses blanches, un an avant la mort de Staline. Après que le régime ait lancé une grande campagne antisémite, un camarade de confession juive est roué de coups à la récréation. Si Boukovski ne le bat pas, il ne fait rien pour lui non plus. Il en tire une incompréhension de la violence à l'état pur (quel lien cet enfant pourrait-il avoir avec les médecins juifs ?) et surtout un sentiment de culpabilité (pourquoi n'a-t-il rien fait ?). (...) A l'époque de ses 10 ans, la mort de Staline le touche comme elle touche un enfant à qui on a toujours parlé du dictateur comme le petit père des peuples : "Pour nous, pour tous, Staline était plus que Dieu". Il explique aujourd'hui que c'était le jour le plus triste de sa vie "car Dieu était mort" ; mais au même moment il comprend que tout n'est qu'une mascarade : "s'Il était Dieu, Il aurait dû être immortel, tout n'était qu'un gros MESONGE". Quelques années plus tard, la déstalinisation lui donne raison. Il cherche alors à comprendre pourquoi on dit maintenant de Staline qu'il est criminel et qui est à l'origine de ces crimes. » « Le contact avec la réalité soviétique. Ce stage en usine puis dans un sovkhoze est sensé le rapprocher de la réalité des travailleurs. Or, le résultat est tout autre. "Nous avons vu, pour la première fois, ce qu'était une usine soviétique, son bluff, son imposture et ses contraintes." » « [En 1997, par un sondage portant sur les articles publiés dans le Monde entre 1990 et le 14 juin 1997, il apparait que] La famine en Ukraine, responsable de cinq à six millions de morts est inconnue, de même que le nombre de camps dont l'existence est au centre de `L'Archipel du Goulag'. Alors que des expositions, des films ou des musées entretiennent le souvenir de l'horreur nazie, il n'est pas fait de même pour le régime soviétique. » « Le `regard amer' porté par Boukovski sur sa vie est analysé par Nicole Zand, dans sa critique écrite dans Le Monde sur `Jugement à Moscou'. Dans une lettre adressée au Monde, Boukovski fait lui-même part de ses `réflexions amères'. Il compare les ex-dissidents aux `hommes en trop' (litchnyï tchelovek) de la littérature russe des XVIIIe et XIXe siècles. » |
Les ex-dissidents, des « gens en trop » ?
Lettre de Boukovski au Monde paru dans l'édition du 16.05.96, extrait :
En effet, aucun de nous n'a été assez naïf pour espérer le triomphe instantané de la démocratie après l'effondrement du communisme. Mais au fond du coeur, beaucoup espéraient montrer à nos compatriotes (par l'exemple personnel, s'il le fallait) que l'on pouvait changer le cours de sa propre vie, et par conséquent le destin du pays, en barrant la route à l'arbitraire et à l'oppression.
Nous espérions démontrer que la démocratie n'était pas une simple farce électorale à échéance de quelques années, mais la participation responsable des gens aux affaires quotidiennes de leur pays. Nous espérions, je crois, qu'un jour l'opinion publique deviendrait une force réelle, comme les ruisseaux du dégel forment un torrent puissant.
« L’opération qui instaure la “totalité” requiert toujours celle qui retranche les hommes “en trop” ; celle qui affirme l’Un requiert celle qui supprime l’Autre. Et cet ennemi, il faut le produire, c’est-à-dire le fabriquer et l’exhiber, pour que la preuve soit là, publique, réitérée, non seulement qu’il est la cause de ce qui risquerait d’apparaître comme signe de conflit ou même d’indétermination, mais encore, qu’il est éliminable, en tant que parasite, nuiseur, déchet » • Claude Lefort, Un homme en trop, Paris, Seuil, 1986, p. 68.
« Le totalitarisme nazi débuta par une organisation de masse qui ne fut dominée que progressivement par les formations d'élites, tandis que les bolchevicks débutèrent par les formations d'élites et organisèrent les masses en conséquence. Le résultat fut le même dans les deux cas. De plus, les nazis, à cause de leur tradition et de leurs préjugés militaristes, modelèrent d'abord leurs formations d'élites sur l'armée, tandis que les Bolcheviks confièrent dès le début l'exercice du pouvoir suprême à la police secrète. Pourtant, au bout de quelques années cette différence disparue également : le chef des SS devint chef de la police secrète, et les formations SS furent progressivement incorporées à la Gestapo, dont elles remplacèrent le personnel en place, bien qu'il fût déjà constitué de nazis sur qui l'on pouvait compter » • Hannah Arendt, Le système totalitaire, Seuil, septembre 2005, p151-152.
« [Thierry] Wolton postule lui à l'idée d'un phénomène déclanchant : en ce qui concerne le communisme, c'est le procès des Khmers rouges qui pourrait être un élément déclenchant, sinon il faudra encore attendre. Mais il se dit assuré que d'ici 2020, l'historiographie sera dominée par l'étude du régime soviétique. » |
Posted 20 years, 1 month ago on August 23, 2007
The trackback url for this post is http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/
The trackback url for this post is http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/
Re: L'« enquête » sur ces faits se limita à un petit mot d'explication
Les ex-dissidents, des « gens en trop » ?
Article paru dans le Monde du 16.05.96
IL y a quelques jours, le facteur m'a apporté une étrange lettre en provenance de la jeune République d'Ouzbékistan, adressée en toute simplicité à « Vladimir Boukovski, Cambridge, Grande-Bretagne ». Quelque peu étonné que la poste ait réussi à me dénicher, j'ai décacheté et lu cela : « Les juifs d'ici continuent à partir pour Israël, les Allemands pour l'Allemagne. Les Russes partent aussi, et leur destination est toute tracée : c'est la Fédération de Russie. Mais nous, les Soviétiques, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et que vont faire nos enfants ? Devons-nous partir pour Cambridge afin d'y rejoindre Boukovski ? Ou alors serons-nous contraints d'aller nous réfugier en Inde, chez Bobby Fisher ? » Signé : Vladimir Goldman, historien, agrégé de philosophie, ancien élève de l'université de Moscou, promotion 1983.
Cette voix qui prêche dans le désert de l'Asie centrale ne demandait pas une réponse, mais je me suis senti en quelque sorte tenu de prendre la plume : « Cher M. Goldman, » Ce n'est sûrement pas ma vocation que de conseiller les Soviétiques ; je ne peux que leur souhaiter de cesser d'être des Soviétiques et de devenir des êtres humains, Cependant, à mon grand regret, il y a encore bien des endroits sur le globe où ils pourraient émigrer : la Chine, la Corée du Nord ou Cuba. Les barrières linguistiques ou les différences culturelles ne devraient pas poser de problèmes à un Homme soviétique, car sa patrie est toujours là où flotte le drapeau rouge. Mais quelle que soit votre décision finale, je vous demande une chose : s'il vous plaît, pas à Cambridge. »
En réalité, M. Goldman n'a aucune raison de se plaindre : qu'il choisisse de rester à Boukhara ou qu'il aille en Russie, il est improbable qu'il manque de drapeaux rouges. L'aspect le plus déprimant du monde postcommuniste est qu'il soit resté soviétique de façon si révoltante, dans son style comme dans son essence. Le régime communiste a eu beau se désagréger et l'Union soviétique s'effondrer, le vainqueur réel de la guerre froide n'en demeure pas moins, sans aucun doute, l'Homme soviétique dans toute sa splendeur.
C'est ce qui explique le gâchis sanglant en Tchétchénie, la nostalgie pour le « bon vieux temps » et les efforts persistants de tant de gens en vue de ressusciter l'Union soviétique (efforts aussi grotesques que le serait la tentative de ressusciter Lénine par décret). Et aussi le « choix » électoral en Russie entre ex-communistes et néocommunistes, avec un Boris Eltsine ressemblant de plus en plus à Leonid Brejnev devant les dernières années de sa vie...
Telles étaient les amères réflexions qui ont donné sa coloration au colloque De la dissidence à la démocratie. Ce colloque, qui s'est tenu à Paris fin mars, a été probablement le premier (et sûrement le plus important) rasssemblement d'intellectuels russes ou occidentaux, anciens dissidents et cold warriors, depuis l'effondrement de l'URSS. Consacré à la mémoire de Vladimir Maximov (disparu à Paris il y a un an), ce fut en soi une sorte de miracle, car les invités qui ont pratiquement tous répondu « présent ! » et beaucoup de bonne volonté ont compensé le manque de fonds. Qui plus est, le désir de nous retrouver et de confronter nos consternations respectives était si grand qu'aucune acrimonie n'a gâché ces deux jours de débats.
Peut-être cette sérénité a-t-elle été favorisée par la visite des participants du colloque au célèbre cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui accorda un asile politique définitif à l'élite de l'art et de la littérature, de la pensée politique et de la philosophie russes de ce siècle, d'Ivan Bounine et de Dimitri Merejkovski à Victor Nekrassov et à Alexandre Galitch, du général Wrangel et ses « Blancs » à Andreï Tarkovski et Rudolf Noureïev.
En effet, c'était une vision qui conviait à l'humilité. Je suppose que, d'une certaine façon, elle ne pouvait que renforcer le sentiment général de défaite subie des mains de l'Homme soviétique, ce « goujat à venir » que Merejkovski a décrit avec une telle éloquence. La profondeur même de ce sentiment a dû rendre dérisoires toutes les autres considérations, y compris les ambitions personnelles et les réglements de comptes mutuels. Quittant le cimetière, chacun s'est inévitablement demandé : « Quelle sorte de nation sommes-nous, dès lors que les meilleurs d'entre nous ont dû mourir en exil ? »
Hélas ! mon correspondant d'Ouzbékistan se trompe : le vrai Russe ne peut toujours pas retourner en Russie, même mort. Il n'y a pas eu d'évolution de la dissidence à la démocratie, malgré tous nos efforts. Peut-être, devait-il en être ainsi : le mouvement dissident n'a jamais été un parti politique pourvu d'une plate-forme clairement définie, mais plutôt un petit groupe d'individus qui comme l'étudiant chinois de la place Tiananmen se tenaient sur le chemin du char totalitaire, le contraignant à changer d'itinéraire. Et le char a bien dévié sa course, n'est-ce pas ? Alors, que pouvait-on espérer d'autre ?
En effet, aucun de nous n'a été assez naïf pour espérer le triomphe instantané de la démocratie après l'effondrement du communisme. Mais au fond du coeur, beaucoup espéraient montrer à nos compatriotes (par l'exemple personnel, s'il le fallait) que l'on pouvait changer le cours de sa propre vie, et par conséquent le destin du pays, en barrant la route à l'arbitraire et à l'oppression.
Nous espérions démontrer que la démocratie n'était pas une simple farce électorale à échéance de quelques années, mais la participation responsable des gens aux affaires quotidiennes de leur pays. Nous espérions, je crois, qu'un jour l'opinion publique deviendrait une force réelle, comme les ruisseaux du dégel forment un torrent puissant.
Ceux de nos amis qui ont manifesté sur la place Rouge en 1968 pour protester contre l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie savaient qu'ils ne pouvaient stopper l'invasion. Ils ont simplement rempli leur devoir de citoyens. Et bien qu'ils aient été arrêtés quelques instants plus tard, le message était clair et simple : si des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue, les tanks auraient changé d'itinéraire. Malheureusement, le message n'était pas parvenu à destination.
Aujourd'hui, vingt-huit ans plus tard, les manifestations de masse auraient facilement stoppé le massacre en Tchétchénie, sans d'ailleurs que personne, cette fois, ne risque l'arrestation. Et pourtant, nous regardons en vain le journal télévisé du soir en espérant ne serait-ce qu'un ruisselet, pour ne pas parler d'un torrent...
Alors, vingt-huit ans plus tard, nous nous regardons et chacun lit la même question muette dans les yeux de l'autre : est-ce que tout cela fut vain, prisons et camps de travail, relégation et hôpitaux psychiatriques ? Sommes-nous ces « gens en trop » si bien décrits dans la grande littérature russe du XIXe siècle ?
Après tout, même ici en Occident, nous ne sommes pas parvenus à changer l'attitude de l'opinion publique à l'égard de notre patrie. De nouveau, comme il y a vingt ans, les gouvernements occidentaux placent leurs espoirs dans les « libéraux » du Kremlin, tout en négligeant totalement l'opinion publique russe. Comme pendant toutes ces décennies, de nouveaux milliards de dollars sont jetés dans le trou noir de la Russie afin de soutenir des « démocrates » inexistants et leurs « réformes » jamais commencées. Et de nouveau, l'argent des contribuables occidentaux finance l'oppression dans un pays lointain, cette fois le pilonnage des villages tchétchènes.
Que pouvons-nous faire ? Refuser de payer nos impôts et aller en prison en Grande-Bretagne et en France, aux Etats-Unis et en Allemagne ? Que pouvons-nous faire en effet si le monde entier souhaite le triomphe de l'Homme soviétique ? Ou peut-être sommes-nous aveugles, égarés et bercés d'illusions en essayant encore et toujours de diviser l'humanité entre « eux » et « nous » alors que la planète tout entière n'a probablement jamais été aussi peuplée de spécimens de l'espèce soviétique ?
Il n'y a qu'une chose dont je suis certain : je n'en veux pas chez moi, à Cambridge.
PAR VLADIMIR BOUKOVSKI
Posted 20 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
Comment Trackback URL : http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/23237/
Article paru dans le Monde du 16.05.96
IL y a quelques jours, le facteur m'a apporté une étrange lettre en provenance de la jeune République d'Ouzbékistan, adressée en toute simplicité à « Vladimir Boukovski, Cambridge, Grande-Bretagne ». Quelque peu étonné que la poste ait réussi à me dénicher, j'ai décacheté et lu cela : « Les juifs d'ici continuent à partir pour Israël, les Allemands pour l'Allemagne. Les Russes partent aussi, et leur destination est toute tracée : c'est la Fédération de Russie. Mais nous, les Soviétiques, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et que vont faire nos enfants ? Devons-nous partir pour Cambridge afin d'y rejoindre Boukovski ? Ou alors serons-nous contraints d'aller nous réfugier en Inde, chez Bobby Fisher ? » Signé : Vladimir Goldman, historien, agrégé de philosophie, ancien élève de l'université de Moscou, promotion 1983.
Cette voix qui prêche dans le désert de l'Asie centrale ne demandait pas une réponse, mais je me suis senti en quelque sorte tenu de prendre la plume : « Cher M. Goldman, » Ce n'est sûrement pas ma vocation que de conseiller les Soviétiques ; je ne peux que leur souhaiter de cesser d'être des Soviétiques et de devenir des êtres humains, Cependant, à mon grand regret, il y a encore bien des endroits sur le globe où ils pourraient émigrer : la Chine, la Corée du Nord ou Cuba. Les barrières linguistiques ou les différences culturelles ne devraient pas poser de problèmes à un Homme soviétique, car sa patrie est toujours là où flotte le drapeau rouge. Mais quelle que soit votre décision finale, je vous demande une chose : s'il vous plaît, pas à Cambridge. »
En réalité, M. Goldman n'a aucune raison de se plaindre : qu'il choisisse de rester à Boukhara ou qu'il aille en Russie, il est improbable qu'il manque de drapeaux rouges. L'aspect le plus déprimant du monde postcommuniste est qu'il soit resté soviétique de façon si révoltante, dans son style comme dans son essence. Le régime communiste a eu beau se désagréger et l'Union soviétique s'effondrer, le vainqueur réel de la guerre froide n'en demeure pas moins, sans aucun doute, l'Homme soviétique dans toute sa splendeur.
C'est ce qui explique le gâchis sanglant en Tchétchénie, la nostalgie pour le « bon vieux temps » et les efforts persistants de tant de gens en vue de ressusciter l'Union soviétique (efforts aussi grotesques que le serait la tentative de ressusciter Lénine par décret). Et aussi le « choix » électoral en Russie entre ex-communistes et néocommunistes, avec un Boris Eltsine ressemblant de plus en plus à Leonid Brejnev devant les dernières années de sa vie...
Telles étaient les amères réflexions qui ont donné sa coloration au colloque De la dissidence à la démocratie. Ce colloque, qui s'est tenu à Paris fin mars, a été probablement le premier (et sûrement le plus important) rasssemblement d'intellectuels russes ou occidentaux, anciens dissidents et cold warriors, depuis l'effondrement de l'URSS. Consacré à la mémoire de Vladimir Maximov (disparu à Paris il y a un an), ce fut en soi une sorte de miracle, car les invités qui ont pratiquement tous répondu « présent ! » et beaucoup de bonne volonté ont compensé le manque de fonds. Qui plus est, le désir de nous retrouver et de confronter nos consternations respectives était si grand qu'aucune acrimonie n'a gâché ces deux jours de débats.
Peut-être cette sérénité a-t-elle été favorisée par la visite des participants du colloque au célèbre cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui accorda un asile politique définitif à l'élite de l'art et de la littérature, de la pensée politique et de la philosophie russes de ce siècle, d'Ivan Bounine et de Dimitri Merejkovski à Victor Nekrassov et à Alexandre Galitch, du général Wrangel et ses « Blancs » à Andreï Tarkovski et Rudolf Noureïev.
En effet, c'était une vision qui conviait à l'humilité. Je suppose que, d'une certaine façon, elle ne pouvait que renforcer le sentiment général de défaite subie des mains de l'Homme soviétique, ce « goujat à venir » que Merejkovski a décrit avec une telle éloquence. La profondeur même de ce sentiment a dû rendre dérisoires toutes les autres considérations, y compris les ambitions personnelles et les réglements de comptes mutuels. Quittant le cimetière, chacun s'est inévitablement demandé : « Quelle sorte de nation sommes-nous, dès lors que les meilleurs d'entre nous ont dû mourir en exil ? »
Hélas ! mon correspondant d'Ouzbékistan se trompe : le vrai Russe ne peut toujours pas retourner en Russie, même mort. Il n'y a pas eu d'évolution de la dissidence à la démocratie, malgré tous nos efforts. Peut-être, devait-il en être ainsi : le mouvement dissident n'a jamais été un parti politique pourvu d'une plate-forme clairement définie, mais plutôt un petit groupe d'individus qui comme l'étudiant chinois de la place Tiananmen se tenaient sur le chemin du char totalitaire, le contraignant à changer d'itinéraire. Et le char a bien dévié sa course, n'est-ce pas ? Alors, que pouvait-on espérer d'autre ?
En effet, aucun de nous n'a été assez naïf pour espérer le triomphe instantané de la démocratie après l'effondrement du communisme. Mais au fond du coeur, beaucoup espéraient montrer à nos compatriotes (par l'exemple personnel, s'il le fallait) que l'on pouvait changer le cours de sa propre vie, et par conséquent le destin du pays, en barrant la route à l'arbitraire et à l'oppression.
Nous espérions démontrer que la démocratie n'était pas une simple farce électorale à échéance de quelques années, mais la participation responsable des gens aux affaires quotidiennes de leur pays. Nous espérions, je crois, qu'un jour l'opinion publique deviendrait une force réelle, comme les ruisseaux du dégel forment un torrent puissant.
Ceux de nos amis qui ont manifesté sur la place Rouge en 1968 pour protester contre l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie savaient qu'ils ne pouvaient stopper l'invasion. Ils ont simplement rempli leur devoir de citoyens. Et bien qu'ils aient été arrêtés quelques instants plus tard, le message était clair et simple : si des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue, les tanks auraient changé d'itinéraire. Malheureusement, le message n'était pas parvenu à destination.
Aujourd'hui, vingt-huit ans plus tard, les manifestations de masse auraient facilement stoppé le massacre en Tchétchénie, sans d'ailleurs que personne, cette fois, ne risque l'arrestation. Et pourtant, nous regardons en vain le journal télévisé du soir en espérant ne serait-ce qu'un ruisselet, pour ne pas parler d'un torrent...
Alors, vingt-huit ans plus tard, nous nous regardons et chacun lit la même question muette dans les yeux de l'autre : est-ce que tout cela fut vain, prisons et camps de travail, relégation et hôpitaux psychiatriques ? Sommes-nous ces « gens en trop » si bien décrits dans la grande littérature russe du XIXe siècle ?
Après tout, même ici en Occident, nous ne sommes pas parvenus à changer l'attitude de l'opinion publique à l'égard de notre patrie. De nouveau, comme il y a vingt ans, les gouvernements occidentaux placent leurs espoirs dans les « libéraux » du Kremlin, tout en négligeant totalement l'opinion publique russe. Comme pendant toutes ces décennies, de nouveaux milliards de dollars sont jetés dans le trou noir de la Russie afin de soutenir des « démocrates » inexistants et leurs « réformes » jamais commencées. Et de nouveau, l'argent des contribuables occidentaux finance l'oppression dans un pays lointain, cette fois le pilonnage des villages tchétchènes.
Que pouvons-nous faire ? Refuser de payer nos impôts et aller en prison en Grande-Bretagne et en France, aux Etats-Unis et en Allemagne ? Que pouvons-nous faire en effet si le monde entier souhaite le triomphe de l'Homme soviétique ? Ou peut-être sommes-nous aveugles, égarés et bercés d'illusions en essayant encore et toujours de diviser l'humanité entre « eux » et « nous » alors que la planète tout entière n'a probablement jamais été aussi peuplée de spécimens de l'espèce soviétique ?
Il n'y a qu'une chose dont je suis certain : je n'en veux pas chez moi, à Cambridge.
PAR VLADIMIR BOUKOVSKI
Posted 20 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
Comment Trackback URL : http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/23237/
Re: L'« enquête » sur ces faits se limita à un petit mot d'explication
Culture Loisirs | Figaro Littéraire
Les hommes "de trop"
CLÉMENCE BOULOUQUE. 28 juin 2007
Yakov Braun - Seuls deux de ses textes ont paru du vivant de l'auteur exécuté en 1937. Aujourd'hui, on publie un recueil de ses nouvelles qui témoigne d'une page de l'histoire soviétique.
LES TEXTES de Yakov Braun ont été retrouvés dans la « commission pour l'héritage artistique des victimes de la répression » et le nom de ces archives témoigne à lui seul d'une page de l'histoire soviétique.
Yakov Braun naît en Ukraine en 1889 dans une famille juive et poursuit des études en Autriche, interrompues par la Première Guerre mondiale - c'est dans ce conflit et dans la tradition juive russe, parcourue par le spectre des pogroms qu'il puise son inspiration, et ses motifs romanesques. De retour en Russie en 1914, il se laisse gagner par l'effervescence politique qui le conduit à adhérer au Parti socialiste révolutionnaire, puis à monter à Moscou en 1917, où il devient critique littéraire et théâtral, brièvement : en 1922, commence la vague des procès des socialistes révolutionnaires et, arrêté en 1923, Yakov Braun connaît le destin des assignés à résidence et autres relégués aux confins de l'URSS.
Une prose aux adjectifs malicieux
En 1937, il est condamné à mort pour appartenance à une organisation terroriste ; exécuté le 7 décembre, il est réhabilité en novembre 1956. Seules deux de ses nouvelles ont paru du vivant de l'auteur. La quasi-intégralité de ses écrits confisquée, détruite, est sans doute à jamais perdue. Comme semblaient l'être les trois nouvelles assemblées dans le recueil Le Gambit du diable, avant d'être retrouvées dans des recoins d'archives, aujourd'hui publiées pour la première fois.
Le premier texte s'ouvre en des temps incertains, lorsque « la joie sans raison n'avait pas encore déserté les veines lumineuses et transparentes des êtres humains ». Mariam-Tova et Samuel ont pour enfant David, qui va être envoyé sur le front en 1914. « Maintenant on considère l'homme et le sang humain comme du vin des vignes, on presse l'homme et on presse les enfants comme s'ils n'étaient pas des enfants mais du simple raisin blanc. »
Lorsque la mère reçoit l'annonce de décès de son fils, elle décide de le cacher à Samuel, et se fait plus belle que jamais. Son époux apprend la disparition et la dissimule, lui aussi, sous un regain d'amour. Ensemble, ils décident de donner une fête, comme s'ils se mariaient à nouveau, sous l'oeil aigre de villageois qui ne comprennent rien à cette ultime danse - où le lecteur entendra les échos de certaines légendes talmudiques, sous les costumes traditionnels russes. Dans une prose aux adjectifs malicieux, la joie folle gagne pour mieux se jeter dans le désespoir et le tenir en respect. Plus encore que Le Gambit du diable, partie d'échec dans une atmosphère crépusculaire, Les Vieux est un texte bouleversant. La dernière nouvelle, Les Yeux, décrit en trois pages une procession de non-voyants éclatant d'une joie étonnante : « Je ne les ai pas vus, mais eux-mêmes ne se voyaient pas non plus. La vérité n'en demeure pas moins vérité. » Et dans ce bonheur aveugle, ce bonheur d'aveugles, perce une métaphore filante.
« Malheur à celui qui est né trop tard ou trop tôt, si l'un et l'autre savent qu'ils sont en retard ou en avance sur leur époque. C'est alors qu'apparaissent les hommes »de trop* ; c'est alors que gémissent les Hamlet et que s'allument les bûchers de l'Inquisition », écrit en 1928 Yakov Braun dans l'une de ses nouvelles. Où la prémonition n'est parfois que clairvoyance.
Posted 20 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
Comment Trackback URL : http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/23238/
Les hommes "de trop"
CLÉMENCE BOULOUQUE. 28 juin 2007
Yakov Braun - Seuls deux de ses textes ont paru du vivant de l'auteur exécuté en 1937. Aujourd'hui, on publie un recueil de ses nouvelles qui témoigne d'une page de l'histoire soviétique.
LES TEXTES de Yakov Braun ont été retrouvés dans la « commission pour l'héritage artistique des victimes de la répression » et le nom de ces archives témoigne à lui seul d'une page de l'histoire soviétique.
Yakov Braun naît en Ukraine en 1889 dans une famille juive et poursuit des études en Autriche, interrompues par la Première Guerre mondiale - c'est dans ce conflit et dans la tradition juive russe, parcourue par le spectre des pogroms qu'il puise son inspiration, et ses motifs romanesques. De retour en Russie en 1914, il se laisse gagner par l'effervescence politique qui le conduit à adhérer au Parti socialiste révolutionnaire, puis à monter à Moscou en 1917, où il devient critique littéraire et théâtral, brièvement : en 1922, commence la vague des procès des socialistes révolutionnaires et, arrêté en 1923, Yakov Braun connaît le destin des assignés à résidence et autres relégués aux confins de l'URSS.
Une prose aux adjectifs malicieux
En 1937, il est condamné à mort pour appartenance à une organisation terroriste ; exécuté le 7 décembre, il est réhabilité en novembre 1956. Seules deux de ses nouvelles ont paru du vivant de l'auteur. La quasi-intégralité de ses écrits confisquée, détruite, est sans doute à jamais perdue. Comme semblaient l'être les trois nouvelles assemblées dans le recueil Le Gambit du diable, avant d'être retrouvées dans des recoins d'archives, aujourd'hui publiées pour la première fois.
Le premier texte s'ouvre en des temps incertains, lorsque « la joie sans raison n'avait pas encore déserté les veines lumineuses et transparentes des êtres humains ». Mariam-Tova et Samuel ont pour enfant David, qui va être envoyé sur le front en 1914. « Maintenant on considère l'homme et le sang humain comme du vin des vignes, on presse l'homme et on presse les enfants comme s'ils n'étaient pas des enfants mais du simple raisin blanc. »
Lorsque la mère reçoit l'annonce de décès de son fils, elle décide de le cacher à Samuel, et se fait plus belle que jamais. Son époux apprend la disparition et la dissimule, lui aussi, sous un regain d'amour. Ensemble, ils décident de donner une fête, comme s'ils se mariaient à nouveau, sous l'oeil aigre de villageois qui ne comprennent rien à cette ultime danse - où le lecteur entendra les échos de certaines légendes talmudiques, sous les costumes traditionnels russes. Dans une prose aux adjectifs malicieux, la joie folle gagne pour mieux se jeter dans le désespoir et le tenir en respect. Plus encore que Le Gambit du diable, partie d'échec dans une atmosphère crépusculaire, Les Vieux est un texte bouleversant. La dernière nouvelle, Les Yeux, décrit en trois pages une procession de non-voyants éclatant d'une joie étonnante : « Je ne les ai pas vus, mais eux-mêmes ne se voyaient pas non plus. La vérité n'en demeure pas moins vérité. » Et dans ce bonheur aveugle, ce bonheur d'aveugles, perce une métaphore filante.
« Malheur à celui qui est né trop tard ou trop tôt, si l'un et l'autre savent qu'ils sont en retard ou en avance sur leur époque. C'est alors qu'apparaissent les hommes »de trop* ; c'est alors que gémissent les Hamlet et que s'allument les bûchers de l'Inquisition », écrit en 1928 Yakov Braun dans l'une de ses nouvelles. Où la prémonition n'est parfois que clairvoyance.
Posted 20 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
Comment Trackback URL : http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/23238/
Re: L'« enquête » sur ces faits se limita à un petit mot d'explication
Portrait
«Il» déserte
Sylvie Testud, 36 ans, actrice. Abandonnée par son père quand elle avait 2 ans, elle l’a remplacé par un pronom personnel. Jusqu’à le retrouver, trente ans plus tard.
Par Charlotte Rotman
QUOTIDIEN : mardi 14 août 2007
Elle avait 2 ans quand «il» est parti. Elle dit «ce monsieur», parfois «cet homme». Elle ne prononce jamais son prénom. Pendant plus de trente ans, Sylvie Testud n’a pas revu son père. Pas une seule fois. Jusqu’à un soir de théâtre à Lyon. Elle était sur scène, lui dans la salle. Aujourd’hui, si on lui demande, elle peut en parler des heures. Elle le fait d’ailleurs avec une légèreté assez gracieuse. Dans sa loge, sur le tournage d’un téléfilm où elle joue Françoise Sagan, puis à la terrasse d’un bar, en fumant clope sur clope, parce que la soirée est douce.
«Il». C’est celui dont on ne parlait pas, à la maison. Petite fille, elle le voit en «démon». «Sinon, comment justifier un abandon ?» «Il» est donc cet «ennemi» qui a quitté une femme et trois petites filles et n’est �jamais revenu. De lui, Sylvie enfant n’a aucun souvenir. «J’ai imaginé moi-même une sorte de fantôme, j’ai construit quelqu’un de mauvais», raconte-t-elle aujourd’hui. «C’était très concret. Je l’ai apprivoisé. Il était comme mon acolyte.» Patiemment, Sylvie Testud a nourri elle-même cette absence qu’aucune anecdote, aucune odeur, aucune trace ne venait raviver. «La mort est très brutale, mais elle suit des moments vécus ensemble. Là, c’est quelqu’un d’absent… Mais qui n’a jamais été présent.»
Quand les adultes de la famille se mettaient à murmurer entre deux portes, c’était toujours à propos de lui. Quand sa mère sifflait - un signe de faiblesse, chez cette Méditerranéenne solide et fière, remise en ménage plusieurs années après avec un autre - c’était à cause de lui aussi. «Il» avait dû faire quelque chose. Téléphoner, peut-être. Sylvie guettait d’invisibles signes.
Enfant, sa sœur aînée prétendait que leur père était mort. Sylvie, elle, barrait d’un trait la fiche de renseignements à l’école. «Il est où ton père ?» elle répondait: «Je sais pas.» «Il fait quoi ?» «Je sais pas.» Ou alors elle inventait des histoires qui variaient selon les circonstances. «Mais je n’étais pas orpheline, je ne me sentais pas coupée d’une moitié de mes parents. Il m’a accompagnée, toutes ces années.»
La porte. La mère avait dit de n’ouvrir «à personne». Elle n’avait pas besoin d’être plus précise, les trois petites filles le savaient : «Le plus grand danger, c’était lui, évidemment.» Il est arrivé qu’«Il» sonne. A l’intérieur, les trois sœurs, trop petites pour regarder à travers le judas, trop respectueuses des mises en garde maternelles, n’ouvraient pas la porte. «On avait le fantasme qu’il courait après nous. Qu’il nous voulait comme sa propriété. On se disait j’ai peur , mais c’était flatteur. On était choisies. C’est mieux que de n’être pas du tout considérées par la personne qui est censée nous avoir désirées.» Il n’est pas �venu souvent. «Deux, peut-être trois fois.» Cela suffisait à trembler et à le voir comme un «père Fouettard, un rôdeur qui pourrait arriver de n’importe où et débouler à n’importe quel moment». Aujourd’hui, Sylvie Testud est persuadée que son père ne venait pas pour ses filles. «Il voulait sa femme, pas les trois mouflets. C’était elle qu’il venait chercher.»
La photo. Elle était dans une boîte en carton bien rangée dans la chambre de la mère. Sylvie, un jour, a voulu «crever un mystère». Curieuse, plus que nostalgique ou triste, elle a cherché et trouvé une photographie, un cliché noir et blanc de lui . Elle s’est dit : «Ça y est, je le tiens dans ma main.» Elle avait huit ans.
Elle lui ressemble. Sa mère a les cheveux crépus et noirs, le teint mat des Italiens du Sud. Sa sœur aînée et sa sœur cadette� �aussi. Sylvie est pâle, elle avait «la peau translucide», qui grillait au soleil quand ses sœurs brunissaient joliment. Elle a les yeux clairs, les cheveux blonds. Elle lui ressemble. Petite, elle entendait dire : «C’est son portrait craché.» Elle trouvait ça «insultant». En même temps, si blanche, elle représentait aussi pour sa famille d’immigrés italiens «la fierté de devenir français». Elle a montré à ses sœurs le butin. Les filles n’en finissaient pas de s’étonner : «Il» a des yeux. «Il» porte des vêtements. Ses cheveux sont en ordre : « Il va donc chez le coiffeur.» Il a un manteau : «C’est qu’ Il peut sentir le froid.» Sylvie Testud raconte la scène dans Gamines, une autobiographie à peine romancée. Lors de l’un de leurs conciliabules d’enfants, les sœurs ont décidé de garder l’image qu’elles ont cachée dans la chambre de l’aînée. Aujourd’hui, Sylvie a toujours la photographie.
L’homme au pull-over vert d’eau. Cela se passe en 2005, à Lyon, son territoire de gamine de la Croix-Rousse, son ancienne «tanière». Sylvie Testud a 34 ans. Elle est connue. Toquée de cinéma depuis qu’elle a vu Charlotte Gainsbourg dans l’Effrontée, elle a rejoint l’écran dès la sortie du �Conservatoire, de Captive en Blessures assassines. Ce soir-là, elle joue la Pitié dangereuse de Stefan Zweig. Elle arrive sur scène en fauteuil roulant, lève les yeux, et tombe sur lui. «Il» est là, en pull vert d’eau. «Il», en chair et en os. En coulisses, elle sonde ses partenaires : «T’as pas vu un mec qui me ressemble ?» La pièce se finit. Dans le hall, personne ne l’attend. «Il» est parti.
L’actrice passe une nuit «exécrable», puis elle demande son numéro aux renseignements et l’appelle. «C’est bien de me téléphoner», lui dit-il, quand il entend sa voix.
La rencontre. Ils ont rendez-vous dans une brasserie, quelques jours plus tard. «Il» est un monsieur attablé devant un jus. Blond, évidemment. «Ses contours sont découpés, là, dans le café», comme s’il n’avait pas d’existence ailleurs. Elle arrive, «sans haine, ni espoir». Elle le vouvoie. Il a vu ses films, lu ses livres, il collectionne les articles sur elle. Elle est stupéfaite : «Je n’imaginais pas qu’il puisse acheter un kilo de tomates, alors, lire un livre ou aller au ciné !» Il connaît même des �répliques par cœur. Sait qu’elle a un chien et une maison à Oléron. Parle d’elle comme d’un «garçon manqué», comme on le disait dans sa famille. «Il �savait tout, ça clôt un peu la �discussion», dit Sylvie Testud. Ses sœurs les rejoignent. Elles, qui sont anonymes, ont le loisir de se présenter. Sylvie a l’impression «d’assister à leur rencontre». Il répète souvent : «Sylvie, elle a la grande vie.»
Elle veut savoir s’il a des enfants, une femme. Il répond : «Non, ça n’a pas marché, après cela ne m’a plus intéressé.» Elle avoue : «Il m’a plu.» Puis ajoute : «Mais quand je l’ai rencontré, j’avais déjà une relation à une figure paternelle. Mon identité s’est construite avec Il , avec cette créature.» La place du père était déjà prise. Alors, elle n’a pas proposé de se revoir.
Elle ne pense pas non plus lui présenter son fils de 2 ans et demi. «Quel besoin ? Cela reviendrait à voir une fiche d’état civil.» �Elle et ses sœurs portent son nom à lui. Un patronyme qui les distingue du clan des Italiens. «Enfants, on le trouvait moche, ce nom, on s’en moquait. Aujourd’hui c’est �davantage le mien que le sien.» Voilà, elle garde de lui le nom, la photo et les traits. Depuis leur rencontre au café, elle lui a envoyé son dernier livre. «Il» ne lui a pas fait �signe.
Sylvie Testud en 7 dates
17 janvier 1971
Naissance à Lyon.
2001
César du meilleur espoir féminin pour «les Blessures assassines».
2003
Premier livre : «Il n’y a pas beaucoup d’étoiles ce soir» (Pauvert).
2004
César de la meilleure actrice pour «Stupeurs et tremblements».
2005
Rencontre son père.
2006
Publie « Gamines» (Fayard).
Eté 2007
Joue Françoise Sagan sous la direction de Diane Kurys.
Posted 20 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
Comment Trackback URL : http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/23239/
«Il» déserte
Sylvie Testud, 36 ans, actrice. Abandonnée par son père quand elle avait 2 ans, elle l’a remplacé par un pronom personnel. Jusqu’à le retrouver, trente ans plus tard.
Par Charlotte Rotman
QUOTIDIEN : mardi 14 août 2007
Elle avait 2 ans quand «il» est parti. Elle dit «ce monsieur», parfois «cet homme». Elle ne prononce jamais son prénom. Pendant plus de trente ans, Sylvie Testud n’a pas revu son père. Pas une seule fois. Jusqu’à un soir de théâtre à Lyon. Elle était sur scène, lui dans la salle. Aujourd’hui, si on lui demande, elle peut en parler des heures. Elle le fait d’ailleurs avec une légèreté assez gracieuse. Dans sa loge, sur le tournage d’un téléfilm où elle joue Françoise Sagan, puis à la terrasse d’un bar, en fumant clope sur clope, parce que la soirée est douce.
«Il». C’est celui dont on ne parlait pas, à la maison. Petite fille, elle le voit en «démon». «Sinon, comment justifier un abandon ?» «Il» est donc cet «ennemi» qui a quitté une femme et trois petites filles et n’est �jamais revenu. De lui, Sylvie enfant n’a aucun souvenir. «J’ai imaginé moi-même une sorte de fantôme, j’ai construit quelqu’un de mauvais», raconte-t-elle aujourd’hui. «C’était très concret. Je l’ai apprivoisé. Il était comme mon acolyte.» Patiemment, Sylvie Testud a nourri elle-même cette absence qu’aucune anecdote, aucune odeur, aucune trace ne venait raviver. «La mort est très brutale, mais elle suit des moments vécus ensemble. Là, c’est quelqu’un d’absent… Mais qui n’a jamais été présent.»
Quand les adultes de la famille se mettaient à murmurer entre deux portes, c’était toujours à propos de lui. Quand sa mère sifflait - un signe de faiblesse, chez cette Méditerranéenne solide et fière, remise en ménage plusieurs années après avec un autre - c’était à cause de lui aussi. «Il» avait dû faire quelque chose. Téléphoner, peut-être. Sylvie guettait d’invisibles signes.
Enfant, sa sœur aînée prétendait que leur père était mort. Sylvie, elle, barrait d’un trait la fiche de renseignements à l’école. «Il est où ton père ?» elle répondait: «Je sais pas.» «Il fait quoi ?» «Je sais pas.» Ou alors elle inventait des histoires qui variaient selon les circonstances. «Mais je n’étais pas orpheline, je ne me sentais pas coupée d’une moitié de mes parents. Il m’a accompagnée, toutes ces années.»
La porte. La mère avait dit de n’ouvrir «à personne». Elle n’avait pas besoin d’être plus précise, les trois petites filles le savaient : «Le plus grand danger, c’était lui, évidemment.» Il est arrivé qu’«Il» sonne. A l’intérieur, les trois sœurs, trop petites pour regarder à travers le judas, trop respectueuses des mises en garde maternelles, n’ouvraient pas la porte. «On avait le fantasme qu’il courait après nous. Qu’il nous voulait comme sa propriété. On se disait j’ai peur , mais c’était flatteur. On était choisies. C’est mieux que de n’être pas du tout considérées par la personne qui est censée nous avoir désirées.» Il n’est pas �venu souvent. «Deux, peut-être trois fois.» Cela suffisait à trembler et à le voir comme un «père Fouettard, un rôdeur qui pourrait arriver de n’importe où et débouler à n’importe quel moment». Aujourd’hui, Sylvie Testud est persuadée que son père ne venait pas pour ses filles. «Il voulait sa femme, pas les trois mouflets. C’était elle qu’il venait chercher.»
La photo. Elle était dans une boîte en carton bien rangée dans la chambre de la mère. Sylvie, un jour, a voulu «crever un mystère». Curieuse, plus que nostalgique ou triste, elle a cherché et trouvé une photographie, un cliché noir et blanc de lui . Elle s’est dit : «Ça y est, je le tiens dans ma main.» Elle avait huit ans.
Elle lui ressemble. Sa mère a les cheveux crépus et noirs, le teint mat des Italiens du Sud. Sa sœur aînée et sa sœur cadette� �aussi. Sylvie est pâle, elle avait «la peau translucide», qui grillait au soleil quand ses sœurs brunissaient joliment. Elle a les yeux clairs, les cheveux blonds. Elle lui ressemble. Petite, elle entendait dire : «C’est son portrait craché.» Elle trouvait ça «insultant». En même temps, si blanche, elle représentait aussi pour sa famille d’immigrés italiens «la fierté de devenir français». Elle a montré à ses sœurs le butin. Les filles n’en finissaient pas de s’étonner : «Il» a des yeux. «Il» porte des vêtements. Ses cheveux sont en ordre : « Il va donc chez le coiffeur.» Il a un manteau : «C’est qu’ Il peut sentir le froid.» Sylvie Testud raconte la scène dans Gamines, une autobiographie à peine romancée. Lors de l’un de leurs conciliabules d’enfants, les sœurs ont décidé de garder l’image qu’elles ont cachée dans la chambre de l’aînée. Aujourd’hui, Sylvie a toujours la photographie.
L’homme au pull-over vert d’eau. Cela se passe en 2005, à Lyon, son territoire de gamine de la Croix-Rousse, son ancienne «tanière». Sylvie Testud a 34 ans. Elle est connue. Toquée de cinéma depuis qu’elle a vu Charlotte Gainsbourg dans l’Effrontée, elle a rejoint l’écran dès la sortie du �Conservatoire, de Captive en Blessures assassines. Ce soir-là, elle joue la Pitié dangereuse de Stefan Zweig. Elle arrive sur scène en fauteuil roulant, lève les yeux, et tombe sur lui. «Il» est là, en pull vert d’eau. «Il», en chair et en os. En coulisses, elle sonde ses partenaires : «T’as pas vu un mec qui me ressemble ?» La pièce se finit. Dans le hall, personne ne l’attend. «Il» est parti.
L’actrice passe une nuit «exécrable», puis elle demande son numéro aux renseignements et l’appelle. «C’est bien de me téléphoner», lui dit-il, quand il entend sa voix.
La rencontre. Ils ont rendez-vous dans une brasserie, quelques jours plus tard. «Il» est un monsieur attablé devant un jus. Blond, évidemment. «Ses contours sont découpés, là, dans le café», comme s’il n’avait pas d’existence ailleurs. Elle arrive, «sans haine, ni espoir». Elle le vouvoie. Il a vu ses films, lu ses livres, il collectionne les articles sur elle. Elle est stupéfaite : «Je n’imaginais pas qu’il puisse acheter un kilo de tomates, alors, lire un livre ou aller au ciné !» Il connaît même des �répliques par cœur. Sait qu’elle a un chien et une maison à Oléron. Parle d’elle comme d’un «garçon manqué», comme on le disait dans sa famille. «Il �savait tout, ça clôt un peu la �discussion», dit Sylvie Testud. Ses sœurs les rejoignent. Elles, qui sont anonymes, ont le loisir de se présenter. Sylvie a l’impression «d’assister à leur rencontre». Il répète souvent : «Sylvie, elle a la grande vie.»
Elle veut savoir s’il a des enfants, une femme. Il répond : «Non, ça n’a pas marché, après cela ne m’a plus intéressé.» Elle avoue : «Il m’a plu.» Puis ajoute : «Mais quand je l’ai rencontré, j’avais déjà une relation à une figure paternelle. Mon identité s’est construite avec Il , avec cette créature.» La place du père était déjà prise. Alors, elle n’a pas proposé de se revoir.
Elle ne pense pas non plus lui présenter son fils de 2 ans et demi. «Quel besoin ? Cela reviendrait à voir une fiche d’état civil.» �Elle et ses sœurs portent son nom à lui. Un patronyme qui les distingue du clan des Italiens. «Enfants, on le trouvait moche, ce nom, on s’en moquait. Aujourd’hui c’est �davantage le mien que le sien.» Voilà, elle garde de lui le nom, la photo et les traits. Depuis leur rencontre au café, elle lui a envoyé son dernier livre. «Il» ne lui a pas fait �signe.
Sylvie Testud en 7 dates
17 janvier 1971
Naissance à Lyon.
2001
César du meilleur espoir féminin pour «les Blessures assassines».
2003
Premier livre : «Il n’y a pas beaucoup d’étoiles ce soir» (Pauvert).
2004
César de la meilleure actrice pour «Stupeurs et tremblements».
2005
Rencontre son père.
2006
Publie « Gamines» (Fayard).
Eté 2007
Joue Françoise Sagan sous la direction de Diane Kurys.
Posted 20 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
Comment Trackback URL : http://justice.cloppy.net/b.blog/bblog/trackback.php/1617/23239/
Perso
Articles récents
Au Garde des Sceaux
Décisions disciplinaires
20 novembre 2005
Qu'est-ce que ça signifie ?
Expert psy absent...
Bientôt noel
Bilan, mi avril 2006
Le procès d'un système
18 mai 2006, appel
Procès et similitudes
Arrêts reçus le 15 juillet
20 novembre 2006
Arrêt du 31 mai 2007
Au juge pour enfants
A propos de ce blog
Au Garde des Sceaux
Décisions disciplinaires
20 novembre 2005
Qu'est-ce que ça signifie ?
Expert psy absent...
Bientôt noel
Bilan, mi avril 2006
Le procès d'un système
18 mai 2006, appel
Procès et similitudes
Arrêts reçus le 15 juillet
20 novembre 2006
Arrêt du 31 mai 2007
Au juge pour enfants
A propos de ce blog
Protection de l'enfance
Pignoufs et pignoufferies
La justice de qualité
L'OSE France
Le code et le livre noir
27 mai 2006, manif
Manif(s) du 14 avril 2007
Envoyé spécial
Voleurs d'enfants
Le signalement
La justice de qualité
L'OSE France
Le code et le livre noir
27 mai 2006, manif
Manif(s) du 14 avril 2007
Envoyé spécial
Voleurs d'enfants
Le signalement
Affaires
Commission Outreau
Affaire Emily
Affaire Zakharova
Affaire Sébastien
Le cas Agret
Grève de Lulu
Philippe Fouquez
Le cas de Sophie
Autres affaires difficiles
Affaire Emily
Affaire Zakharova
Affaire Sébastien
Le cas Agret
Grève de Lulu
Philippe Fouquez
Le cas de Sophie
Autres affaires difficiles
Calendrier
| « March 2026 » | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Articles récents
Serge Klarsfeld...
Les Français condamnent à...
Le SNES attaque le site...
Les CM2 seront...
Breteau mis en examen
Les Français condamnent à...
Le SNES attaque le site...
Les CM2 seront...
Breteau mis en examen
Sections
Manif(s) du 14 avril 2007
2007, juste le désordre
Le 3919
Actions et manifestations
L'adoption
Affaire d'Anger
Affaire Maddie
Le cas Agret
L'appel des 100
L'Arche de Zoé
Associations et liens
L'astrologie
Le cas Bamberski
En Belgique
Le cas Betancourt
Les bêtes
La justice à Bobigny
Le cas Boukovski
Boulettes
Quai Branly
Le cas Britney
La Caisse d'Epargne
Campagne 2007
Ca se discute
Le cas Enis
Clearstream
Commission Outreau
Les concubines
La corrida
Collusions et corruption
CPE
Les grands crus
Déviants et hérétiques
Discrimination et impostures
Société
Faits divers
Les docu-fictions
Douce France
Affaire EADS
Education nationale
Affaire Emily
Pour un enfant
Envoyé spécial
Le traité d'extradition
Fête des Loges
Le foot
Fusillade à Malakof
Gay prides
Le génocide
Affaire Gettliffe
Guy Drut
Un peu d'histoire
Les huîtres d'Arcachon
L'improbable
L'industrie
Les infirmières bulgares
L'inquisition
Insolite
Arrêts reçus le 15 juillet
Le JPE de Metz
Mais qui est Julie ?
La justice de Bourges
La justice de qualité
La descente de Laffrey
Dérives
Textes et Morale
Le cas des sourds
Le débat
Le Tour
La liste électorale
Le code et le livre noir
Livres, bibliographie
Grève de Lulu
Le mensonge
L'ordre moral
Actualités personnelles
L'OSE France
Outreau
Outreau saison 2
Outreau saison 3
La liste du père Noël
Personnes agées
Pierrot le fou
La place de l'enfant
La plume des psys
Proche orient
La protection de l'enfance
Centres de rétention
La rue
Rumeur et crédibilité
Le scooter de Jean
Affaire Sébastien
Au mémorial de la shoah
Le signalement
Affaires difficiles
Evolutions du site
L'affaire du SMS
Société Générale
Suicides
Tintin au Congo
Tolérance zéro
Troubles urbains
UNICEF
Deux vitesses
Affaire Zakharova
Zéro de conduite
2007, juste le désordre
Le 3919
Actions et manifestations
L'adoption
Affaire d'Anger
Affaire Maddie
Le cas Agret
L'appel des 100
L'Arche de Zoé
Associations et liens
L'astrologie
Le cas Bamberski
En Belgique
Le cas Betancourt
Les bêtes
La justice à Bobigny
Le cas Boukovski
Boulettes
Quai Branly
Le cas Britney
La Caisse d'Epargne
Campagne 2007
Ca se discute
Le cas Enis
Clearstream
Commission Outreau
Les concubines
La corrida
Collusions et corruption
CPE
Les grands crus
Déviants et hérétiques
Discrimination et impostures
Société
Faits divers
Les docu-fictions
Douce France
Affaire EADS
Education nationale
Affaire Emily
Pour un enfant
Envoyé spécial
Le traité d'extradition
Fête des Loges
Le foot
Fusillade à Malakof
Gay prides
Le génocide
Affaire Gettliffe
Guy Drut
Un peu d'histoire
Les huîtres d'Arcachon
L'improbable
L'industrie
Les infirmières bulgares
L'inquisition
Insolite
Arrêts reçus le 15 juillet
Le JPE de Metz
Mais qui est Julie ?
La justice de Bourges
La justice de qualité
La descente de Laffrey
Dérives
Textes et Morale
Le cas des sourds
Le débat
Le Tour
La liste électorale
Le code et le livre noir
Livres, bibliographie
Grève de Lulu
Le mensonge
L'ordre moral
Actualités personnelles
L'OSE France
Outreau
Outreau saison 2
Outreau saison 3
La liste du père Noël
Personnes agées
Pierrot le fou
La place de l'enfant
La plume des psys
Proche orient
La protection de l'enfance
Centres de rétention
La rue
Rumeur et crédibilité
Le scooter de Jean
Affaire Sébastien
Au mémorial de la shoah
Le signalement
Affaires difficiles
Evolutions du site
L'affaire du SMS
Société Générale
Suicides
Tintin au Congo
Tolérance zéro
Troubles urbains
UNICEF
Deux vitesses
Affaire Zakharova
Zéro de conduite
Powered by bBlog

Chez Seuil, 1971, extrait de la page 31 :