September 25, 2005
Les classiques des sciences sociales
L'enfant confié à une famille d'accueil va-t-il changer ? La question de l'acculturation des enfants placés en familles d'accueil interroge toujours le sens du projet de vie du jeune concerné. Les modèles proposés à l'enfant en souffrance n'offrent pas la garantie qu'ils vont être suivis par ce dernier. Cet article rend compte de la construction de l'identité de l'enfant ou de l'adolescent confronté au choc des cultures dans le cadre d'un placement familial.
INIST-CNRS 002B30A11,
Le Colporteur, CREAHI Champagne-Ardenne
Émile ou De l'éducation (1762) « Tout est bien sortant de l'auteur des choses ; tout dégénère entre les mains de l'homme » Livre second, L’âge de nature : de 2 à 12 ans (puer) [203:] C’est ici le second terme de la vie, et celui auquel proprement finit l’enfance; car les mots infans et puer ne sont pas synonymes. Le premier est compris dans l’autre, et signifie qui ne peut parler: d’où vient que dans Valère Maxime on trouve puerum infantem. Mais je continue à me servir de ce mot selon l’usage de notre langue, jusqu’à l’âge pour lequel elle a d’autres noms. [204:] Quand les enfants commencent à parler, ils pleurent moins. Ce progrès est naturel: un langage est substitué à l’autre. Sitôt qu’ils peuvent dire qu’ils souffrent avec des paroles, pourquoi le diraient—ils avec des cris, si ce n' est quand la douleur est trop vive pour que la parole puisse l’exprimer? S’ils continuent alors à pleurer, c’est la faute des gens qui sont autour d’eux. Dès qu’une fois Emile aura dit: J’ai mal, il faudra des douleurs bien vives pour le forcer de pleurer. [205:] Si l’enfant est délicat, sensible, que naturellement il se mette à crier pour rien, en rendant ces cris inutiles et sans effet, j’en taris bientôt la source. Tant qu’il pleure, je ne vais point à lui; j’y cours sitôt qu’il s’est tu. Bientôt sa manière de m’appeler sera de se taire, ou tout au plus de jeter un seul cri. C’est par l’effet sensible des signes que les enfants jugent de leur sens, il n’y a point d’autre convention pour eux: quelque mal qu’un enfant se fasse, il est très rare qu’il pleure quand il est seul, à moins qu’il n’ait l’espoir d’être entendu. [206:] S’il tombe, s’il se fait une bosse à la tête, s’il saigne du nez, s’il se coupe les doigts, au lieu de m’empresser autour de lui d’un air alarmé, je resterai tranquille, au moins pour un peu de temps. Le mal est fait, c’est une nécessité qu’il l’endure; tout mon empressement ne servirait qu’à l’effrayer davantage et augmenter sa sensibilité. Au fond, c’est moins le coup que la crainte qui tourmente, quand on s’est blessé. Je lui épargnerai du moins cette dernière angoisse; car très sûrement il jugera de son mal comme il verra que j’en juge: s’il me voit accourir avec inquiétude, le consoler, le plaindre, il s’estimera perdu; s’il me voit garder mon sang-froid, il reprendra bientôt le sien, et croira le mal guéri quand il ne le sentira plus. C’est à cet âge qu’on prend les premières leçons de courage, et que, souffrant sans effroi de légères douleurs, on apprend par degrés à supporter les grandes. [207:] Loin d’être attentif à éviter qu’Emile ne se blesse, je serais fort fâché qu’il ne se blessât jamais, et qu’il grandît sans connaître la douleur. Souffrir est la première chose qu’il doit apprendre, et celle qu’il aura le plus grand besoin de savoir. Il semble que les enfants ne soient petits et faibles que pour prendre ces importantes leçons sans danger. Si l’enfant tombe de son haut, il ne se cassera pas la jambe; s’il se frappe avec un bâton, il ne se cassera pas le bras; s’il saisit un fer tranchant, il ne serrera guère, et ne se coupera pas bien avant. Je ne sache pas qu’on ait jamais vu d’enfant en liberté se tuer, s’estropier, ni se faire un mal considérable, à moins qu’on ne l’ait indiscrètement exposé sur des lieux élevés, ou seul autour du feu, ou qu’on n’ait laissé des instruments dangereux à sa portée. Que dire de ces magasins de machines qu’on rassemble autour d’un enfant pour l’armer de toutes pièces contre la douleur, jusqu a ce que, devenu grand, il reste à sa merci, sans courage et sans expérience, qu’il se croie mort à la première piqûre et s'évanouisse en voyant la première goutte de son sang? |
September 23, 2005
Réseau Européen Droit & Société
http://www.reds.msh-paris.fr/«Nous sommes un certain nombre à avoir combattu, à un titre ou à un autre, avec des arguments qui se ressemblent souvent beaucoup, l'explication scientifique proposée par Kelsen, Duguit et Weyr. Nous avons dénoncé la démarche de nos devanciers qui tendait à la purification de l'objet, et nous nous sommes précisément regroupés au nom de son «impureté»... parce que nos recherches nous ont enseigné que le droit est un phénomène historique, culturel et social autant que logique...» Revue Droit et Société, 1, 1985, p. 11 Critique de la raison juridique. T1. Où va la sociologie du droit ? A.J. Arnaud, CNRS 2.2.1.1. La France au microscope Extraits : L’existence d’un enseignement de sociologie juridique tient à l’initiative personnelle d’un professeur intéressé par ce thème. Une première constatation s’impose donc : il y a encore peu d’enseignants tentés, en France, par la sociologie juridique, et la demande, dans les U.E.R. de droit, ne paraît pas excéder l’offre. Cet état d’esprit correspond assez bien à la manière dont les étudiants conçoivent une telle discipline. Loin de se précipiter, à l’annonce d’un tel enseignement, pour en profiter, ils le boudent, pour la plupart. Où trouver l’explication ? La réponse, certainement, n’est ni simple ni univoque. Il faut évoquer, sans doute, le caractère apparemment peu pratique de la discipline. L’analyse sociologique est encore mésestimée dans la plupart des professions auxquelles se destinent les étudiants en droit privé. Plus soucieux de se préparer à une vie professionnelle où la sociologie juridique ne leur paraît pas devoir les aider substantiellement, que d’acquérir une culture qui leur semble étrangère à la mise en oeuvre quotidienne du droit, pourquoi iraient-ils perdre leur temps hors des sentiers dogmatiques ? Il faut ajouter que les candidats à l’enseignement du droit eux-même, qui connaissent bien les tendances et les lubies des membres potentiels de leurs jurys d’examen ou de concours, se gardent bien de s’engager sur la voie de la sociologie juridique, de peur de produire des travaux qu’on irait ensuite leur reprocher d’avoir réalisés, ou dont on ne tiendrait que peu de compte, comme s’il s’agissait de fruits de la pure fantaisie. |
Un réquisitoire contre les « bagnes d'enfants »
Le Monde, 22.04.05 La déportation et les camps en France Dans la zone Nord, occupée, le chef supérieur de la police et des SS paraphe, le 29 mai 1942, un décret obligeant les juifs "de plus de 6 ans" à porter, "bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine", une étoile "à six branches", dans tous les lieux publics. "Elle est en tissu jaune et porte, en caractères noirs, l'inscription 'Juif'."' Cette loi ne s'applique pas dans la zone "libre". Mais, le 2 juin 1942, le régime de Vichy durcit ses mesures antisémites et impose le recensement de tous les juifs, "dans un délai d'un mois", au sein des préfectures et sous-préfectures. Ce recensement était déjà organisé dans la zone occupée. Entre-temps, le décret baptisé "Nuit et Brouillard" (Nacht und Nebel) est adopté par Hitler le 7 décembre 1941, visant la Résistance et l'opposition politique. Il stipule que "tout habitant des territoires occupés de l'Ouest, présumé coupable de crimes contre le Reich ou contre les territoires d'occupation, doit être exécuté ou déporté clandestinement en Allemagne, pour y disparaître sans qu'aucune information ne soit donnée à son sujet". Le camp de Drancy : Drancy est un camp d'internement et de transit, d'où s'ébranlèrent 67 des 79 convois partis de France. Il a été installé dans les bâtiments HLM construits en "U" dans cette banlieue de l'est de Paris. L'armée allemande les a réquisitionnés en 1941, initialement pour les juifs étrangers. |
Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière", Numéro 3, 2000
L'enfant de justice pendant la guerre et l'immédiat après-guerre
Extraits :
2) La censure de Vichy ... le film fut surtout amputé d'une séquence essentielle et qu'il importe ici de restituer. Nous sommes de nouveau dans les scènes se déroulant à l'Hôtel du Parc, quand Jean Victor accompagné de ses deux acolytes, Malory et Ferrand, tente d'obtenir d'un fonctionnaire guindé l'autorisation d'ouvrir son centre de rééducation en se livrant à un réquisitoire contre les « bagnes d'enfants » : Jean Victor : « Il ne faut plus que l'on traite les enfants comme des bêtes et que les pénitenciers soient des fabriques de révoltes. On les bride, on les écrase sous prétexte de les redresser et puis [ensuite] on les rejette à la rue comme des épaves. Ce système-là a fait faillite. C'est une honte pour notre pays de l'avoir toléré si longtemps...Il ne doit plus y avoir de bagnes pour les enfants » [...] Le fonctionnaire : « Il ne faut rien exagérer ! Moi qui vous parle, j'ai appartenu autrefois à l'administration pénitentiaire. Je connais bien la question...je vous assure qu'il court beaucoup de légendes sur les pénitenciers de jeunes délinquants » Jean Victor se contenant : « Pourtant il y a des faits qui ne sont pas niables » Le fonctionnaire dit tranquillement avec son sourire sceptique : « Oui...quelques petits abus...des cas isolés...dont la presse s'était emparée avant la guerre...permettez-moi de vous le dire...heureusement ils ont été d'ailleurs sévèrement réprimés...maintenant tout cela est très surveillé, croyez-moi...Ces jeunes chenapans sont conduits avec beaucoup plus de douceur qu'on ne l'imagine... » Malory, incapable de se contenir s'est levé d'un bond : « Eh bien ! vous en avez un culot, vous ! » Le fonctionnaire stupéfait balbutie : « Comment ? » Jean Victor intervient : « Excusez mon ami, Monsieur. Il est étonné et il y a de quoi ! Si vous êtes de bonne foi...alors c'est qu'on vous cache tout » Ferrand, ouvrant tout à coup sa chemise et montrant sur son cou une longue cicatrice, crie à son tour : « Et ça ? C'en est de la douceur ? Un coup de poinçon d'un gardien à l'atelier de menuiserie à Eysses... » |
Des références et travaux centrés sur le champ des « représentations », des « imaginaires » ou de la « mémoire » :
Vichy, la justice et les Juifs pose des questions essentielles et troublantes sur la facilité avec laquelle il est possible, même en démocratie, de pervertir les institutions sous couvert de légalité. Un livre de Richard H. Weisberg, professeur en droit institutionnel, premièrement publié en 1996 par NYU Press, traduit en français et publié en 1998 par les Editions des archives contemporaines . Le Monde diplomatique, juillet 2004 Quatre livres soulignent l’intérêt porté aux « années sombres » de la France, entre les années 1930 et la Libération. La France sous Vichy Autour de Robert O. Paxton 2004, Editions Complexe, collection «Histoire du temps présent» Trente ans après la traduction de La France de Vichy (1973), une vingtaine d’historiens rendent hommage à Robert O. Paxton. Cet universitaire américain, de son regard, à la fois étranger et distant, a changé durablement les représentations collectives des «années noires». Dans une historiographie alors axée sur les responsabilités allemandes ou sur l’histoire de la résistance, il a opéré une révolution épistémologique, déplaçant l’angle d’observation de l’occupant allemand vers l’«État français». Il a révélé ainsi à quel point ce dernier avait exercé une politique propre, marquée par le choix de la collaboration d’État et celui d’une rupture définitive avec la République. Le présent ouvrage offre un bilan de la production savante de ces vingt dernières années et dresse des perspectives de recherche. Il donne un aperçu des travaux sur les rapports entre occupants et occupés, d’un point de vue politique, social ou culturel, en insistant sur des questions touchant à l’opinion, aux réactions de la société française, à la vie quotidienne. Le volume se termine par une interrogation concernant le souvenir récent de cette période dans l’imaginaire français, et sur la place qu’y occupe désormais l’historien américain, devenu à sa manière un «lieu de mémoire». La protection sociale sous le régime de Vichy Auteur(s): Sous la direction de Philippe-Jean Hesse & Jean-Pierre Le Crom - éd. Presse universitaire de Rennes, 2001, (382 p. ; 23 €) On connaissait déjà la dette que l’éducation spécialisée pouvait avoir à l’égard du régime de Vichy. Voilà un ouvrage qui vient éclairer d’une façon très étonnante l’héritage tout aussi douteux que peut avoir le système de protection sociale de notre pays. En 1928 et 1930, la France se dote, cinquante ans après l’Allemagne et vingt-cinq ans après la Grande Bretagne, d’une d’assurance sociale couvrant le risque maladie. En 1945, le plan de Sécurité sociale vient compléter et élargir notablement ce dispositif. Mais que s’est-il passé entre 1940 et 1944 ? CNDP, La Police des années noires France5 sur le câble : dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 janvier 2005, 0 h 55 Un documentaire de Jean-Marc Berlière et Arnaud Gobin (2002), coproduit par France 5 et Zeaux Productions. 52 min Dans les années 1930, la police nationale avait mauvaise réputation. Elle inquiétait, faisait peur et était la proie de toutes les rumeurs. Exécutant les basses œuvres d’un régime politique déconsidéré, elle terrorisait les républicains et était détestée par les communistes. Ceux de l’extrême droite l’associaient à une Tcheka occulte et franc-maçonnique. Puis vint la guerre... Qu’allaient devenir ces fonctionnaires, sous l’œil attentif des nazis, dans le cadre d’un régime discriminatoire et autoritaire ? C’est cette période obscure et encore sensible pour beaucoup que Jean-Marc Berlière et Arnaud Gobin ont pris le parti de présenter. Sans concession. France Culture, semaine du 24 Février 2004 Un hôpital psychiatrique français sous l’occupation Le temps est venu depuis une poignée d’année de faire de cette histoire tragique et reléguée un enjeu du présent. Des faits divers dans le grand brouhaha de l’horreur, la mort de ces « aliénés » demande à s’inscrire dans notre histoire assumée. |
Décembre 2000, rapport N°2, première partie
COMMISSION EXTRA MUNICIPALE
D'ETUDE DE LA SPOLIATION DES BIENS JUIFS
A BORDEAUX ET MERIGNAC
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
les archives du Commissariat Général aux Questions Juives
relatives à la Gironde (C.G.Q.J.)
D'ETUDE DE LA SPOLIATION DES BIENS JUIFS
A BORDEAUX ET MERIGNAC
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
les archives du Commissariat Général aux Questions Juives
relatives à la Gironde (C.G.Q.J.)
Une administration consacrée à la "Question Juive" Le Commissariat Général aux Questions Juives est institué le 29 mars 1941. Il est chargé entre 1941 et 1944 de coordonner les mesures de spoliation à l'égard des personnes considérées comme juives au regard des différents statuts et lois promulgués par l'Etat français et les autorités d'occupation. Doté de compétences très larges, le CGQJ absorbe en juin 1941 un premier service chargé de l'aryanisation économique, le Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), qui lui est rattaché. Il fusionne ensuite avec la direction de l'Aryanisation économique en mai 1942. Puis, rattaché à la vice-présidence du Conseil, le CGQJ dépend par la suite du Ministère de l'Intérieur, puis du chef du Gouvernement, conformément à la loi du 6 mai 1942. Les missions du CGQJ sont multiples : - préparation des textes réglementaires et législatifs ; - examen des affaires d'aryanisation contentieuses ; - recherche des infractions au statut des "juifs" ; - contrôle depuis la loi du 29 novembre 1941 l'Union Générale des Israélites de France (UGIF) ; - aryanisation économique. Conformément à la loi fondamentale du 22 juillet 1941, il a le pouvoir de "nommer un administrateur provisoire à : 1°) Toutes les entreprises industrielles, commerciales, immobilières ou artisanales, 2°) Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque, 3°) Tout bien meuble, valeur mobilière ou droit mobilier quelconque, lorsque ceux à qui ils appartiennent, ou qui les dirigent, ou certains d'entre eux sont "juifs"." |
September 16, 2005
« On nous a cramé le cerveau »
«On nous a cramé le cerveau.» Pour résumer son histoire, Jean-Pierre Jean-Marie ne trouve aucune autre expression. Dans ce raccourci verbal, il a glissé tous ses maux : son départ précipité de Saint-Denis à l'âge de 12 ans, ses rêves déchus d'«études brillantes et de grandes écoles», l'autorisation provisoire de placement qu'ont signée ses parents en 1966 et «qui a duré trente ans», le doute d'avoir fait une bêtise au point de mériter «ça», mais aussi le temps perdu «qu'on ne rattrape jamais».Le Figaro, 16 septembre 2005
Les déracinés de la Réunion s'en prennent à l'État
Par Anne-Charlotte De Langhe
Voir également « Ca vallait le coup. »
Le Monde, Les enfances dérobées de la réunion 16 août 2005. Les enfants ont grandi. Ils entrent dans la cinquantaine, l'âge des questionnements existentiels. Une quinzaine d'entre eux attaquent l'Etat devant le tribunal administratif de Limoges. Motifs : "Violation des lois sur la famille et sur la protection de l'enfance, violation des conventions internationales, non-respect des droits de l'enfant" (Le Monde du 18 août). A la fin de cette semaine, une quinzaine d'autres vont faire appel à Bordeaux d'une précédente décision négative rendue en juillet à la Réunion. Ai-je réussi ma vie ? Que serait-il advenu si ? Aurais-je pu être quelqu'un d'autre ? M'a-t-on, en quelque manière, volé ma vie ? C'est une réponse à ces doutes que les Réunionnais de la Creuse réclament aujourd'hui à la justice. Entre 1963 et 1981, selon un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1 600 mineurs seront ainsi transférés. Des Caravelle spéciales décollent, plusieurs fois l'an, avec des enfants de tous âges. Les nourrissons sont cédés à des familles adoptives, parfois dès l'arrivée à Orly. Les plus grands, souvent noirs ou métis, sont envoyés dans des centres d'accueil, à Guéret (Creuse), à Quézac (Cantal), à Albi (Tarn) ou à Lespignan (Hérault). Les services sociaux vont mettre un zèle particulier à une mission qui, selon l'IGAS, jouira de "l'attention personnelle de Michel Debré" . Les familles en difficulté sont légion. Misère, alcoolisme, illettrisme font des ravages. Les 2 CV de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (Ddass) vont sillonner l'île pour alimenter le pont aérien et contenter leurs supérieurs. |
September 14, 2005
L'avis du président de la Banque United Dominion
Je tiens à déclarer que je ne suis ni communiste, ni bolchevik, je suis sans nul doute un capitaliste et un individualiste... La Russie progresse au moment où beaucoup trop de nos usines sont inactives et où près de trois millions d'individus de notre pays cherchent désespérément du travail. On a raillé le plan quinquennal et on en a prédit la faillite. Mais soyez certains qu'on a fait plus que le plan quinquennal s'était proposé de faire... Dans toutes les villes industrielles que j'ai visitées, j'ai vu bâtir, d'après un plan déterminé, de nouveaux quartiers avec de larges rues plantées d'arbres et dotées de squares, avec des maisons du type le plus moderne, avec des écoles, des hôpitaux, des clubs ouvriers et les inévitables pouponnières et jardins d'enfants, où l'on prend soin des bébés des mères-ouvrières... N'essayez pas de sous-estimer les Russes et leurs plans, et ne commettez pas la faute d'espérer que le gouvernement soviétique puisse s'effondrer... La Russie d'aujourd'hui est un pays doué d'une âme et d'un idéal. La Russie est un pays d'une activité étonnante. J'ai la conviction que les aspirations de la Russie sont saines... Le plus important, c'est peut-être que toute la jeunesse et les ouvriers de la Russie ont une chose qui, malheureusement, fait aujourd'hui défaut dans les pays capitalistes, à savoir l'espérance.Appréciation donnée en octobre 1932 par le capitaliste anglais Gibson Jarvie, président de la Banque United Dominion.
Encyclopédie marxiste, le léninisme, tome III
Ouvrage publié en 1970 aux Editions "Naim Frashëri", Tirana
Centre de Documentation et de Recherches Marxistes
La France sous Vichy Autour de Robert O. Paxton 2004, Editions Complexe, collection «Histoire du temps présent» Trente ans après la traduction de La France de Vichy (1973), une vingtaine d’historiens rendent hommage à Robert O. Paxton. Cet universitaire américain, de son regard, à la fois étranger et distant, a changé durablement les représentations collectives des «années noires». Dans une historiographie alors axée sur les responsabilités allemandes ou sur l’histoire de la résistance, il a opéré une révolution épistémologique, déplaçant l’angle d’observation de l’occupant allemand vers l’«État français». Il a révélé ainsi à quel point ce dernier avait exercé une politique propre, marquée par le choix de la collaboration d’État et celui d’une rupture définitive avec la République. Le présent ouvrage offre un bilan de la production savante de ces vingt dernières années et dresse des perspectives de recherche. Il donne un aperçu des travaux sur les rapports entre occupants et occupés, d’un point de vue politique, social ou culturel, en insistant sur des questions touchant à l’opinion, aux réactions de la société française, à la vie quotidienne. Le volume se termine par une interrogation concernant le souvenir récent de cette période dans l’imaginaire français, et sur la place qu’y occupe désormais l’historien américain, devenu à sa manière un «lieu de mémoire». |
September 13, 2005
L'image du « voleur de poules » a 60 ans
Le Dalloz - Les détracteurs de l'ordonnance de 1945 font valoir que ce texte n'est plus adapté à la situation actuelle ? J.-P.R. - On entend ce discours depuis 20 ou 30 ans ! La délinquance des mineurs, avril 2002 |
Il s'est tenu un colloque au cours du quel a été discuté l'opportunité de réforme ou d'adaptation de l'ordonnance de 1945 concernant la délinquance juvénile.
la justice des mineurs de l'époque s'occupe surtout de la masse des délits banals contre les biens. C'est l'image du « voleur de poules » qui vient à l'esprit, s'agissant d'une société encore largement rurale et fort préoccupée par les problèmes de ravitaillement à ce moment.
Entre 1936 et 1952 - Les changements les plus importants sont l'augmentation de la punitivité sous le régime de Vichy, marquée par une multiplication des peines et une diminution massive de la proportion des filles parmi les mineurs poursuivis dans l'après-guerre.
Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière » N°3, 2000, L'enfant de justice pendant la guerre et l'immédiat après-guerre
Libération titre aujourd'hui « A 60 ans, la justice des mineurs cherche une nouvelle jeunesse »
Chazal de Mauriac - Premier Président de la Cour d'Appel de Paris - parie plutôt sur la mise en oeuvre concrète d'expériences de terrain. Et surtout pour l'élaboration d'outils d'évaluation. «Notre faiblesse véritable, c'est l'absence d'un système d'évaluation pour vérifier la pertinence de certaines options, et éviter des erreurs et des polémiques inutiles.» A son avis, «les politiques extrêmes, libérales ou répressives[1]» sont à bannir. Car elles reposent «sur des analyses sommaires ou erronées, sur des visions utopiques ou cyniques, sur la démagogie». Selon lui, le vrai défi de ce début de siècle, «c'est de ne pas se laisser fasciner par une politique qui répondrait au seul slogan : plus vite et plus fort».
En fait, les jeunes délinquants n'intéressent pas vraiment grand monde. «Entre les adeptes du réarmement moral qui ont peu de sympathie pour ceux qu'ils considèrent comme des déviants, les individualistes qui s'intéressent essentiellement à leur propre épanouissement et à celui de leurs proches[2], les partisans d'un repli défensif sur ceux qui leur ressemblent, leur communauté, leur groupe... pas facile de trouver des appuis pour une grande politique à l'égard des jeunes délinquants», regrette Chazal de Mauriac.
[1] Extrait de l'Humanité du 16 août 2005, La cité des 4000 entre fantasme et réalité, 14 000 habitants au total selon l'article : Les mots du ministre de l’Intérieur : « Je viens nettoyer au Karcher... », « l’ordre... », « l’insécurité... » Des expressions fortes. Et un engagement étonnant de la part d’un membre du gouvernement : « Je reviendrai autant de fois qu’il le faudra. » La cité des 4000 est officiellement devenue le laboratoire expérimental de l’action politique selon Sarkozy. « Pourquoi vient-il chez nous alors que ce n’est pas pire qu’ailleurs ? » La question revient souvent parmi les habitants, largement partagés entre ceux qui critiquent et ceux qui approuvent les propos du ministre d’État. ... S’il y a des expressions fortes dans les propos du ministre, le mot de « misère » y est superbement oublié. Pénétrer dans la cité des 4000, c’est découvrir une réalité ignorée, palper l’ampleur du désastre humain. 59% des ménages ont des revenus inférieurs au plafond d’attribution du plan locatif aidé (PLA), habituellement utilisé pour mesurer la pauvreté et la précarité. La part des familles monoparentales (en fait des femmes élevant seules leurs enfants) est deux fois plus importante que dans l’ensemble de la région parisienne. Les gamins souffrent de carences affectives autant que de carences alimentaires. Quasi toutes les écoles sont classées en zone d’éducation prioritaire. « Même la caisse d’allocations familiales (CAF) confirme que nous avons la population la plus pauvre du département, souligne Mimouna, militante associative (voir ci-dessous). Le quotient familial y est le plus bas de Seine-Saint-Denis. 60% des familles ne paient pas leur loyer, certaines depuis deux mois, d’autres depuis plus de dix ans. » [2] A chaque affaire il se constitue un comité de soutien autours des victimes et un autre aux côtés des auteurs des faits : GRENOBLE (AFP), 13 septembre 2005, extrait - La ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, s'était rendue sur les lieux de l'incendie pour apporter son soutien aux gendarmes de Saint-Laurent-du-Pont. GRENOBLE (AP), 13 septembre 2005, extraits - Dix adolescents et deux jeunes majeurs ont été placés en garde à vue mardi matin dans le cadre de l'enquête sur un incendie d'origine criminelle qui a détruit le 3 septembre une partie de la caserne de gendarmerie de Saint-Laurent-du-Pont (Isère), a-t-on appris auprès de la gendarmerie. L'enquête s'est orientée vers les proches des deux jeunes qui se trouvaient en garde à vue pour "coups et blessures" dans les locaux de la gendarmerie au moment de l'incendie. Le feu s'était déclaré dans un bateau garé le long du bâtiment administratif et s'était propagé dans les bureaux. |
September 4, 2005
Placets et lettres de cachet
De l'avis de la CEDH : « ... Les pressions sur les parents pour s’en remettre aux services sociaux pour aboutir à une séparation de la famille sont des pratiques contraires au droit proclamé. » « Certaines décisions judiciaires constituent des ingérences, des restrictions imposées par les autorités publiques aux droits fondamentaux. Elles font l’objet d’un contrôle de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. » « Lors de ce contrôle, la Cour peut substituer son appréciation à celles des autorités nationales. » Voir aussi les fausses allégations et « du contrôle social à la demande sociale. » |
Une lettre de cachet est, sous l’Ancien Régime en France, une lettre servant à la transmission d’un ordre du roi.
Dans un sens général, il s’agit d’une sorte de lettre close (par oppositions aux lettres patentes, c’est-à-dire ouvertes), scellée par le sceau du secret[1]. Les lettres adressées au Parlement pour lui mander d’enregistrer un édit portaient ainsi ce nom.
À partir du XVIIe siècle, le sens de l’expression s'est spécialisé. La lettre de cachet devient un ordre privatif de liberté[2], requérant l’emprisonnement, l’élargissement ou l’éloignement d'une personne. La lettre relève de la justice retenue du roi : elle court-circuite le système judiciaire ordinaire. En effet, les personnes visées ne sont pas jugées mais placées d’emblée dans une prison d’État (Bastille, forteresse de Vincennes) ou une maison de force (Hôpital général).
Une lettre de cachet peut être expédiée du mouvement du roi. C’est typiquement le cas des incarcérations politiques, telles celles de Voltaire ou de Diderot. Elle peut également l’être sur requête d'un particulier[3]. Ainsi, Voltaire lui-même requiert une lettre de cachet pour l’incarcération d'une tripière menant tapage dans le voisinage. En effet, cette intervention royale est souvent demandée pour des affaires privées où les plaignants voulaient agir rapidement et sans tapage public. C’est ainsi que le père de Mirabeau demande une lettre de cachet pour faire embastiller son fils, au motif de son inconduite. Après réception de la demande, celle-ci est examinée par le lieutenant général de police ou par un intendant. De 1741 à 1775, près de 20 000 lettres sont ainsi expédiées.
Source: Wikipedia.org
[1] Je n'ai pas eu accès au dossier du Juge des Enfants autrement que par l'intermédiaire de mes avocats. [2] Ma fille est séquestrée depuis le 23 novembre 2003. Elle devrait disparaitre à terme en Alsace-Lorraine. Le Juge des Enfants a demandé des examens me concernant... [3] La tante Assistante Sociale de l'ASE(57) aurait écrit au Juge des Enfants[1]. La tante Assistante Sociale de l'ASE(57) a été en relation avec ses consoeurs des Hauts de Seine, l'a été avec Madame Josefsberg de l'OSE qui a menée la mission d'investigation demandée par le Juge des Enfants et elle est également en relation avec Monsieur Josefsberg qui est le Directeur de l'établisement gardien. La tante Assistante Sociale de l'ASE(57) est également en relation avec sa soeur, Madame Isabelle Clementz chez qui ma fille doit être placée à terme. |
Acte souverain, la lettre de cachet émane du roi ; elle ordonne l'internement. Ce type de placement "administratif" n'est pas plus arbitraire que le placement en maison de Force qui n'est soumis à aucune formalité. La lettre de cachet doit suivre une procédure : la famille rédige un placet, l'intendance enquête[4]... La lettre de cachet est aussi le reflet d'une société où la famille est maîtresse de la liberté de ses membres[5], les surveille et les interne si besoin est. La Révolution Française abolit les lettres de cachet, mais maintient les fous enfermés. 90% des lettres de cachet étaient demandées par les familles en vue de l'emprisonnement des marginaux et déviants, donc des fous.
Source: Centre hospitalier Charcot,
Histoire de la psychiatrie: l'âge classique (XVIIe siècle)
[4] l'ASE et l'OSE ont « enquêté. » L'OSE rend encore des rapports... [5] Sur ce dossier, la famille maternelle - la tante Assistante Sociale de l'ASE(57) - et la famille Josefsberg seraient maitresses de la liberté des miens. |
Critiques de la puissance paternelle et des lettres de cachet. La puissance paternelle est perpétuelle dans les pays de droit écrit (car influence du droit romain), i.e. droit de correction et enfermement à vie !. Le père peut obtenir un ordre d’arrestation du juge ou du roi lui-même (lettre de cachet, ordres individuels, lettre fermée). Les lettres de cachet, peu utilisées mais symbolisent l’arbitraire, dénonciation par Mirabeau qui a été victime de plusieurs lettres de cachet demandées par son père, de Voltaire, Beccaria. Demandent une nouvelle définition de l’autorité parentale : le but n’est pas la répression, mais l’éducation, rôle important de Rousseau avec l’émile ou de l’éducation, 1762.
Histoire du droit, notes personnelles
Introduction historique au droit, l'émancipation des personnes
Deug I Droit, 1ère année, 1er semestre, 35h, cours magistral
Il n'existe pas véritablement de justice dite publique : les crimes et délits poursuivis relèvent davantage d'un ordre moral que d'un ordre public. L'ancien droit ne connaît qu'un seul ordre juridictionnel, chargé à la fois de trancher les litiges entre particuliers et de juger les infractions pénales.
En 1670, une Ordonnance réglemente pour la première fois la procédure criminelle. De caractère inquisitoire et secrète, elle aboutit à une comparution de l'accusé devant une juridiction siégeant généralement à huis clos sans l'assistance d'un avocat. Les infractions n'ont toutefois été ni définies ni classées, laissant place au pouvoir discrétionnaire des juges.
Les peines quant à elles ont pour seul fondement l'intimidation et l'expiation du coupable par des châtiments corporels. La prison pour peine est à l'époque quasiment inexistante.
Il n'existe pas non plus de justice de droit public. L'idée qu'un sujet puisse se plaindre du fait de l'autorité est incompatible avec une royauté de droit divin.
On en appelle à la Justice du Roi, sans qu'il y ait véritablement une justice de droit public.
Source: justice.gouv.fr, en 1670,
une Justice essentiellement privée
Du résumé et des conclusions d'un article intitulé « Armée française et désertion au XVIIIe siècle » qui décrit une notion d'incitation au « regret » par l’autorité :
« Il s’agit de faire de la place au « regret » des déserteurs et d’instituer une dispense de peine[6] pour ceux qui sont revenus de leur propre chef au régiment. Cette mesure a pour but de créer, chez le soldat, un clivage intérieur entre désir de fuite et envie du retour. L’article tente de s’interroger sur ce moment de l’intrusion de l’institution dans l’émergence de l’émotion. »
« Pour conclure, nous pouvons évoquer les pratiques des lettres de cachets, adresses directes faites au roi, dont Arlette Farge et Michel Foucaut relèvent le « singulier statut du repentir ». A la différence de la justice ordinaire peu préoccupée de l’attitude personnelle du criminel, la punition émanant du roi ne s’arrête pas, selon leur analyse, au corps mais implique l’âme qu’il faut guérir ou corriger[7]. « L’acquièscement et la soumission du condamné » qui doivent surgir au terme de l’enfermement est également un objectif de la politique du retour volontaire[8]. De même la justice militaire cherche à s’emparer de l’âme des soldats. Cette mesure peut susciter chez l’homme un doute, une hésitation, un clivage intérieur entre retour et non-retour, visant à s’immiscer dans l’intime[9] du soldat. Elle se veut clémente, renonçant à toute forme de contrainte[10]. On peut pourtant y voir un lieu d’exercice de la domination symbolique, forme de pouvoir qui s’exerce sur les corps en dehors de toute contrainte physique, « en s’appuyant sur des dispositions déposées, telles des ressorts, au plus profond des corps », dans ce cas le dispositif religieux de la pénitence[11]. Le regret ou le repentir que les soldats sont amenés à éprouver relèvent sans doute de ces « émotions corporelles », à travers lesquelles l’individu va se soumettre au jugement dominant, soutenant dans ce cas l’institution[12]. »
[6] Contrairement à ce que souhaiteraient faire croire de nombreux intervenants sur ce dossier, je ne suis pas un « déserteur. » Le Juge des Enfants m'a informé que je ne serais pas poursuivi pour mes attitudes abandonniques et mon ambivalence - pour l'exemple, je souhaite le retour de ma fille et j'ai entretenu des relations avec elle mais certains rapports de l'établissement de Taverny parraissent le contredire. [7] Le Juge des Enfants souhaite rompre la relation père-enfant mais ni ma fille ni moi ne souhaitons de cela. [8] Il s'agirait plutôt de me soumettre et d'accepter qu'à terme, ma fille disparaitra en Alsace-Lorraine. [9] Ce dossier cumule les atteintes à l'autorité parentale et les imiscions dans la relation père-enfant mais également dans les relations entre l'enfant et les autres membres de sa famille (sa soeur et sa belle-mère), ses amis et ses proches en région parisienne. [10] Le Juge des Enfants souhaiterait que je le remercie d'avoir placé - de m'avoir débarassé ! - de ma fille. [11] Très judéo-chrétien... [12] Jamais je ne soutiendrais l'institution tant qu'elle ne privilégiera pas la relation père-enfant ; l'institution n'est que l'outil que la tante Assistante Sociale de l'ASE(57) emploie abusivement pour parvenir à ses fins : « garder » sa nièce. |
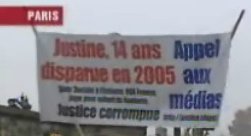
« Contribution au travail de séparation en internat »
Richard Josefsberg,
Directeur de l'établissement de Taverny
L’éducation, la chose nous semble aller de soi, a partie liée, et même doublement, avec la culture. Nous la concevons, d’une part, comme un processus d’acculturation, c'est-à-dire d’intégration de l’enfant dans la vie sociale ; de l’autre, comme une introduction aux grandes œuvres intellectuelles et artistiques de l’humanité.
Culture et dénaturation
Rousseau, ou l’éducation naturelle
Dans le champ de la psychologie, Fritz Redl a introduit le concept d’« ego resilience » en 1969 ; puis a été décrit le phénomène appelé « invulnerable children ». Enfin, au milieu des années 1980, plusieurs ouvrages consacrés à la « résilience » ont été publiés, analysant le destin réussi d’individus que leur enfance catastrophique semblait pourtant promettre à un sombre avenir.
Aux Etats-Unis, cependant, rien de comparable à l’extraordinaire engouement que connaît aujourd’hui la France pour ce concept. Pourquoi ? D’abord grâce à un génial tour de passe-passe... La résilience, qui est en Amérique une vertu sociale associée à la réussite, est devenue en France une forme de richesse intérieure... Il ne s’agit plus, comme dans la version américaine, d’orienter sa vie pour connaître le succès, mais de « chercher la merveille » ou encore de « cultiver l’art de rebondir ». Pourtant, sous cette séduisante parure, le produit reste le même.
Le mot « résilience » est d’abord ambigu, car il masque le caractère toujours extrêmement fragile des défenses développées pour faire face aux traumatismes. La résistance psychique s’apparente dans son évolution à la résistance physique face à un cancer connu. Le patient est aidé, traité au mieux, mais nul ne maîtrise ses rechutes possibles. Et c’est seulement lorsque le malade est mort que l’on peut dire, selon les cas, s’il a bien résisté ou non !
Extraits du Monde Diplomatique d'août 2003
« Résilience » ou la lutte pour la vie