December 13, 2005
Le naufrage du pétrolier Erika
PARIS (Reuters), 13 décembre 2005 - Un rapport d'expertise impute à des malversations le naufrage du pétrolier Erika au large de la Bretagne en 1999, a déclaré Me Alexandre Varaut, avocat de communes victimes de la marée noire qui avait suivi.Le Conseil général de Vendée et les communes de Vendée et du Morbihan viennent de recevoir, sur instruction du tribunal de commerce de Dunkerque, un rapport d'expertise qui avait été commandé et payé par le groupe Total.
Ce rapport dédouane le groupe pétrolier français, du moins sur le plan technique, mais accuse en revanche le propriétaire du navire, Giuseppe Savarese, la société Panship, chargée de sa gestion technique, et la société italienne de classification Rina (Resgistro italiano navale).
"Il est confirmé que le naufrage n'est pas dû à la malchance ou à des conditions de mer exceptionnelles mais bien à d'authentiques malversations", écrit Me Varaut dans un communiqué.
L'armateur de l'Erika avait "décidé, avec la complicité de la société de contrôle, de diviser par six le budget alloué aux réparations immédiatement nécessaires, ce qui est directement à l'origine du drame", ajoute l'avocat, sur la base du rapport.
Selon ce rapport, ce sont seulement 19 tonnes de tôles qui ont été remplacées au lieu de 220 tonnes, ce qui a réduit la facture de 500.000 dollars à 134.000.
Un document justifiant les travaux effectués triche en outre sur l'épaisseur des tôles, ce que ne pouvait ignorer le Rina, qui a pourtant laissé l'Erika prendre la mer.
"Cette situation ne peut être le résultat de simples erreurs matérielles", souligne le rapport cité par Me Varaut.
VERS UN RENVOI EN CORRECTIONNELLE ?
Pour lui, les "fautes lourdes" ainsi mises en avant "excluent que l'on oppose aux victimes un quelconque plafond de réparation". Les communes concernées seront donc fondées à demander réparation pour la totalité de leurs préjudices économiques et écologiques.
L'Erika, qui battait pavillon maltais, s'était brisé en deux le 12 décembre 1999 dans une tempête. Le pétrole s'échappant des cuves avait souillé 400 kilomètres de côtes.
Le groupe Total, sur les responsabilités duquel la juge d'instruction Dominique de Talancé a apparemment un autre avis que le rapport d'expertise, devrait être prochainement renvoyé en correctionnelle comme personne morale.
Pour le parquet de Paris, Total était propriétaire de la cargaison et s'est comportée en "maître du navire" pendant le dernier voyage du bateau, ce qui contredirait la défense de groupe selon laquelle le transport ne la concernait pas.
Total n'aurait pas procédé avant l'embarquement du bateau à un contrôle détaillé par ses propres soins. Or, cette procédure, le "vetting", est en principe obligatoire chez Total.
C'est à la juge Dominique de Talancé, qui a prononcé la mise en examen de la société en 2001, que revient la décision finale.
Le parquet demande le renvoi en correctionnelle de sept autres personnes morales et physiques mises en examen, dont la société Rina, Giuseppe Savarese et le capitaine indien du pétrolier, Karun Mathur.
Une condamnation de Total pourrait déboucher sur une lourde amende et de fortes indemnisations pour les collectivités et les victimes de la marée noire, parties civiles.
Les indemnisations déjà versées spontanément par Total et par le Fonds d'indemnisation de l'industrie pétrolière (Fipol) ont été jugées tardives et limitées. De nombreuses personnes, comme les pêcheurs à pied, en ont été exclues.
December 6, 2005
Un avis récent du Monde Diplomatique
En marge du pouvoir économiqueQue reste-t-il de la démocratie ?
Le Monde diplomatique, août 2004
Par José Saramago
Ecrivain portugais,
prix Nobel de littérature 1998.
Auteur, entre autres,
du Dieu manchot, Seuil, Paris, 1995 ;
de La Caverne, Seuil, Paris, 2002 ;
et d’Essai sur la lucidité, à paraître au Seuil cet automne
Extraits :
La question principale que tout type d’organisation humaine se pose, depuis que le monde est monde, est celle du pouvoir. Et le principal problème est d’identifier celui qui le détient, de vérifier par quel moyen il l’a obtenu, l’usage qu’il en fait, les méthodes qu’il utilise, et quelles sont ses ambitions.
Si la démocratie était vraiment le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, tout débat cesserait. Mais on n’en est pas là. Et seul un esprit cynique se risquerait à affirmer que tout va pour le mieux dans le monde dans lequel nous vivons.
On dit aussi que la démocratie est le système politique le moins mauvais, et nul ne remarque que cette acceptation résignée d’un modèle qui se contente d’être « le moins mauvais » peut constituer le frein à une quête vers quelque chose de « meilleur ».
[...] Les peuples n’ont pas élu leurs gouvernements pour que ceux-ci les « offrent » au marché. Mais le marché conditionne les gouvernements pour que ceux-ci leur « offrent » leurs peuples. A notre époque de mondialisation libérale, le marché est l’instrument par excellence de l’unique pouvoir digne de ce nom, le pouvoir économique et financier. Celui-ci n’est pas démocratique puisqu’il n’a pas été élu par le peuple, n’est pas géré par le peuple, et surtout parce qu’il n’a pas pour finalité le bonheur du peuple.
Deux Manière de Voir...
N°82, Pages d’histoire occultées
ÉVÉNEMENTS OUBLIÉS
Mais la seconde guerre mondiale n’est pas la seule victime de ces phénomènes d’amnésie sélective. Des pages de l’histoire de l’humanité ont disparu des mémoires, en ont été effacées ou y ont été réécrites, non sans arrière-pensées : de la traite et de l’esclavage à la liquidation des Panthères noires, en passant par la Révolution française, la colonisation de l’Algérie, l’expulsion des Palestiniens, la révolte ouvrière à Berlin-Est et le procès Eichmann...
N°80, Combats pour les médias
UN DISCRÉDIT CROISSANT
L’information et l’analyse ont-elles pour de bon cédé le pas au racolage commercial et à la morale ? On connaissait la propagande de guerre, c’est désormais le matraquage en boucle d’« émotions » mises en scène et vite oubliées. Condamnés par le tribunal des médias, des innocents se voient ensuite sanctifiés par leurs anciens accusateurs. Et puis tout recommence. La formation des journalistes mais aussi le mutisme complice des intellectuels jouent leur rôle dans ce naufrage.
December 3, 2005
Ce serait la fin des « affaires »
L'ère des grandes affaires politico-financières est révolueArticle paru dans l'édition du Monde du 17.07.05
Extraits :
AINSI, ce serait la fin des « affaires ». Depuis quelques années, les milieux judiciaires, policiers, politiques - et journalistiques - se nourrissent de cette conviction commune : les enquêtes politico-financières ont vécu. L'époque des « petits juges » s'attaquant aux ministres, députés et autres chefs de parti serait révolue.
Ce constat abrupt mérite certes d'être nuancé. Toutefois, de nombreux indices attestent que la justice financière a tourné une page de sa courte histoire. Une multitude de facteurs expliquent cette mutation.
Les camouflets infligés aux magistrats financiers. Le début des années 2000 a été marqué par une série de désaveux pour les juges d'instruction chargés des dossiers sensibles. Il y eut ainsi, en novembre 2001, la relaxe de l'ancien ministre des finances du gouvernement Jospin, Dominique Strauss-Kahn, dans l'affaire de la MNEF, suivie de celle de l'ancien secrétaire national du PCF, Robert Hue, dans celle du Gifco. Vinrent encore le dessaisissement du juge Eric Halphen, dont l'emblématique enquête sur les HLM de Paris était truffée d'erreurs de procédure, ou la relaxe de Roland Dumas, dans un volet de l'affaire Elf. Ces « claques » ont affaibli les magistrats financiers dans leur ensemble.
Par ailleurs, l'immunité pénale accordée à Jacques Chirac en 1999 par le Conseil constitutionnel - et confirmée en 2001 par la Cour de cassation - a encore accentué leur découragement. Juges et policiers financiers ont vécu comme un camouflet le statut d'« intouchable » accordé au chef de l'Etat, pourtant au centre de plusieurs dossiers majeurs (HLM de Paris, lycées d'Ile-de-France, financement du RPR, chargés de mission de la mairie de Paris...).
Le départ des « juges stars ». Plusieurs juges médiatiques, adeptes des actes d'instruction spectaculaires, sont partis. Eva Joly a regagné sa Norvège natale, Laurence Vichnievsky a accédé à la présidence du tribunal de Chartres, Isabelle Prévost-Desprez a également quitté l'instruction... Quant à Eric Halphen, il s'est mis en congé de la magistrature. Tous ont fait part de leur lassitude, voire de leur découragement. Aujourd'hui, le pôle financier parisien abrite encore deux juges connus du grand public : Philippe Courroye et Renaud Van Ruymbeke.
Cependant, si ces magistrats instruisent plusieurs dossiers sensibles (Total, frégates de Taïwan...), ils le font dans la discrétion. L'un comme l'autre ne paraissent guère goûter au vedettariat, refusant notamment d'accorder des entretiens à la presse.
La fin des enquêtes-fleuves.
Objets de toutes les critiques, les instructions-fleuves, comme celle sur les faux électeurs du 3e arrondissement de Paris (seize ans d'enquête !), sont désormais bannies. Les juges, sous la pression des parquets - notamment dans la capitale - bouclent plus rapidement leurs investigations, quitte à laisser de côté certaines pistes ouvertes par leurs enquêtes. De ce fait, les dossiers sensibles ne se transforment plus en interminables feuilletons aux multiples rebondissements. Le juge Courroye incarne cette nouvelle politique. Il a traité en un temps record (moins d'un an) les enquêtes visant Pierre Bédier et Charles Pieri. Même son instruction sur les ventes d'armes vers l'Angola, aux nombreuses ramifications internationales, a été clôturée en moins de cinq ans.
Des dossiers anciens.
Une opinion publique moins sensible.
Tout se passe comme si, désormais, les citoyens tenaient pour acquis la corruption d'une partie de la classe politique.
Les médias contribuent à cette banalisation.
Ce sont les faits divers et le fonctionnement de la justice elle-même qui sont désormais au coeur des préoccupations. Une évolution que les hommes politiques ont encouragée, voire suscitée.
Une nouvelle politique pénale.
Les lois Perben ont accru le pouvoir accordé aux procureurs - placés sous la tutelle du ministre de la justice.
Poursuivie par son successeur, Jean-Claude Marin, elle est mal vécue par les juges d'instruction, qui dénoncent un affaiblissement de leurs prérogatives et une reprise en main » politique. De fait, le parquet de Paris privilégie les enquêtes préliminaires, placées sous son contrôle, au détriment des informations judiciaires, et rechigne à délivrer des réquisitoires supplétifs (qui permettent d'étendre les investigations des juges).
Des pratiques plus transparentes.
Les dérives semblent désormais le fait d'individus, ce qui les rend aussi plus difficiles à détecter.
De nouvelles affaires.
Après avoir attaqué la sphère politique, les magistrats concentrent leurs efforts sur le monde économique. Paradoxalement, si les sommes en jeu sont plus importantes, l'impact de ces affaires dans l'opinion est bien plus faible.
D'autre part, pour l'opinion, ces nouvelles affaires, qui mettent en jeu des mécanismes complexes (Vivendi, Rhodia...), sont souvent moins compréhensibles que les dossiers politico-financiers.
December 2, 2005
La corruption dans les associations
Voir Société Civile N°29, octobre 2003.Le N°21 de janvier 2003 est un complément intéressant :
SC : En quoi consiste cette "lenteur de la justice" ?
HL : Tout le monde sait - et en particulier ceux qui sont directement concernés - que la justice est lente. Mais ce que j’ai voulu montrer dans mon livre c’est que la situation est encore beaucoup plus grave qu’on ne le croit car c’est une lenteur ahurissante. Dès qu’on sort d’une affaire simple, on se retrouve dans une procédure qui dure 5, 10 ans, sinon plus. C’est insupportable car vous avez un décalage de plus en plus grand entre le rythme de la vie et celui de la justice. C’est une justice du temps de la voiture à cheval.
JUSTICE, UNE LENTEUR COUPABLE Hervé LEHMAN, Hors collection, 192 pages Droit/Sc. politiques / Relat. inter. Philo histoire droit Doctrine juridique octobre 2002 ISBN 2130530877 «Une lenteur coupable» Tous ces maux sont-ils uniquement dus à un problème de budget, comme nombre d'organisations professionnelles le proclament? Pas si sûr. Certes, celui consacré à la justice en France (5,037 milliards d'euros en 2003, 1,6% du PIB) est deux fois moins important que dans bon nombre de pays européens. De quoi donner quelques arguments aux syndicats lors de leurs rencontres avec le garde des Sceaux. Mais ce point de vue n'est toutefois pas partagé par tous les observateurs de la justice. Ainsi Hervé Lehman, avocat au barreau de Paris et ancien juge d'instruction, a, dans son livre Justice, une lenteur coupable (PUF), développé une vision différente s'appuyant sur sa propre expérience des deux côtés de la barricade. Extrait de l'Express du 30/04/2003, Le réquisitoire des avocats Du Société Civile N°8, mars 2001, choquant ! |
Le trucage des chiffres
En France, on est très respectueux des chiffres officiels. Personne ne les conteste, les médias les utilisent régulièrement et les politiques les citent sans méfiance. A défaut d'organismes privés qui puissent donner d'autres chiffres, fournir des informations différentes, nuancées, en particulier sur l'utilisation de l'argent public, ces organismes officiels (instituts, ministères, agences publiques et para-publiques) représentent la seule source disponible.Dans ce Dossier, l'iFRAP livre quelques nouveaux truquages. Les deux premiers exemples concernent des statistiques fournies par les administrations françaises à l'OCDE. En effet, d'après les statisticiens de l'OCDE, les chiffres utilisés dans la réalisation de leurs tableaux proviennent des administrations et (ou) des instituts français. Une demande précise est faite par l'OCDE auprès des organismes nationaux (en l'occurrence, français) pour obtenir des données sur plusieurs sujets. Ensuite, le pays questionné communique ses données qui sont introduites dans la base de données de l'OCDE. Le problème est de voir dans quelle mesure les chiffres communiqués par les organismes nationaux sont fiables. L'iFRAP a découvert que les statistiques sur le nombre de fonctionnaires et le nombre de lits dans les hôpitaux fournies par les administrations françaises étaient fausses.
De même, plusieurs services publics se contentent de donner des chiffres imaginaires sur les prix ou les accidents (à la SNCF) pour montrer que les usagers n'ont rien à gagner dans l'éventualité d'une réforme. Ou bien des syndicats choisissent de donner une information truquée pour obtenir plus de budget et plus de personnels.
On peut douter des statistiques fournies par la Corée du Nord, par Cuba, la Chine ou d'autres Etats où sévit une dictature dont la principale préoccupation est de manipuler les statistiques économiques dans son propre intérêt. Pourtant, les mêmes désinformations à des fins de propagande peuvent aussi provenir de la part de pays démocratiques et riches. C'est, malheureusement, le cas de la France. En voici les preuves.
Extrait de Société Civile N°33 de février 2004, iFRAP
December 1, 2005
Indice de corruption 2005
France, 2005 : 7.5 (7.0 - 7.8)France, 2002 : 6.3 (4.8 - 7.8)
“La corruption n’est pas une catastrophe naturelle : c’est un pillage froid et calculé de nombreuses opportunités pour les hommes, femmes et enfants qui sont le moins à même de se protéger” a déclaré David Nussbaum, directeur exécutif de TI. ”Les dirigeants doivent aller au delà des simples promesses orales et tenir leur parole de fournir les ressources nécessaires pour s’engager dans l’amélioration de la gouvernance, de la transparence et de la responsabilité redditionnelle.
Source: Transparency International
L'avis de Lord Emerich Edward Dalberg Acton
“La liberté requiert de se protéger du contrôle des autres, ce qui exige maîtrise de soi et, par conséquent, une influence religieuse et spirituelle, de l'éducation, des connaissances et une bonne santé physique et morale.”“si le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument.”
Lord Emerich Edward Dalberg Acton (1834–1902)
Source: www.acton.org
Guide à l'usage des parlementaires
Protection de l'Enfance, guide à l'usage des parlementairesN°7, 2004, UNICEF, extrait de la page 35 :
Les élus peuvent donner de la voix pour rompre le silence qui entoure les problèmes associés à la protection de l'enfant. Les questions liées à cette protection sont souvent délicates, cachées sous le voile de la honte, du secret, de la stigmatisation ou de la corruption. Ce sont des sujets tabous, a fortiori s'il est question de sexe ou de religion. Un tel silence fait obstacle à la protection de l'enfant; il est impossible de mobiliser les citoyens en vue de l'action nécessaire quand les problèmes que l'on évoque ne sont pas censés exister. En mettant les questions liées à la protection de l'enfant sur la place publique et en s'attaquant à des problèmes délicats, les parlementaires font la preuve de leurs qualités de dirigeants; ils peuvent ainsi renverser l'un des principaux obstacles qui, dans de nombreux pays, empêchent d'aborder la question de la protection de l'enfant.
Page 14 du même guide : On ne peut offrir une protection et des soins adéquats que dans un environnement qui favorise et protège tous les droits, dont celui de n'être pas séparé de ses parents, le droit au respect de la vie privée, le droit d'être protégé contre la violence, le droit à une protection particulière et à une assistance de l'État, les droits des enfants handicapés, le droit à la santé, le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, le droit à l'éducation et aux loisirs, le droit d'être protégé contre l'exploitation économique, l'usage illicite des stupéfiants et l'exploitation sexuelle, le droit d'être protégé contre l'enlèvement, la vente et la traite des enfants, ainsi que contre la torture et toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale. Pourrait être disponible sur La Documentation Française : >> Mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant : Note d'étape sur la protection de l'enfance. - Patrick BLOCHE (Présid.) ; Valérie PÉCRESSE (Rapp.), 28 juin 2005, 25 p. >> L'amélioration de la procédure de signalement de l'enfance en danger. Rapport du groupe de travail, 30 juin. - Philippe NOGRIX (Présid.) ; Catherine HESSE-GERMAIN (Rapp.) ; Arnauld GRUSELLE (Rapp.)/Ministère de la famille et de l'enfance, juin 2005, 14 p. + ann. >> L’amélioration de la prise en charge des mineurs protégés. -Louis de BROISSIA. Ministère de la famille et de l'enfance, juillet 2005, 43 p. |
November 30, 2005
Renforcer l'éthique dans le service public
Publication date: 06 Oct 2000Language: French
Pages: 360
ISBN: 9264287981
Price: €47
Il est impératif que les services publics inspirent confiance à la population. Les citoyens attendent des agents de la fonction publique qu’ils veillent à l’intérêt public en toute équité et qu’ils gèrent correctement les ressources de l’État au quotidien. S’ils sont équitables et fiables, les services publics inspirent confiance à la population et créent un climat propice aux activités des entreprises, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés et à la croissance économique. Le respect de l’éthique est une condition préalable implicite pour que l’opinion publique accorde sa confiance à l’administration. Il est aussi un élément capital de la bonne gouvernance.
En cette période de consensus croissant entre les pouvoirs publics sur la définition des éléments indispensables d’une stratégie effective et globale de l’éthique, le présent rapport de l’OCDE contient une somme d’informations sur les dispositions en matière de gestion de l’éthique résultant de comparaisons entre les pays de l’OCDE, et dont il n’existe actuellement aucun équivalent. Cet ouvrage est destiné à favoriser l’apprentissage mutuel et à aider les décideurs à élaborer des stratégies modernes en matière d’éthique, tant dans les pays Membres que dans les pays non membres de l’Organisation. Il présente - pour la première fois - un panorama complet des dispositions concernant l’éthique adoptées par les 29 pays membres de l’Organisation, et comprend notamment les tendances générales et les pratiques particulièrement intéressantes.
Gérer les conflits d'intérêts dans le service public Publication date: 25 Aug 2005 Language: French Pages: 276 ISBN: 9264104941 Price: €28 Les conflits d'intérêts sont aujourd’hui un thème essentiel du débat de société dans le monde entier. De nouvelles formes de conflits émergent entre les intérêts privés et les missions des agents publics à mesure que le secteur public travaille en liaison plus étroite avec le secteur privé marchand et non marchand et adopte des solutions commerciales inspirées par ce secteur. Les autorités doivent s'assurer que ces agents s’acquittent de leur tâche avec équité et impartialité. Les citoyens et les entreprises, mieux informés, exercent en ce sens une pression croissante. Cette pression correspond à une exigence générale d’impartialité et de transparence de la prise de décision publique. Le message est clair : les intérêts personnels ne doivent pas affecter les décisions officielles, il faut défendre l'intégrité des marchés et la saine concurrence des entreprises, et exclure les malversations. Les Lignes directrices de l'OCDE pour la gestion des conflits d'intérêts dans le service public constituent la première référence internationale en la matière. Elles aident les autorités à réexaminer et à moderniser leurs politiques relatives aux conflits d’intérêts dans le secteur public. A travers une étude comparative générale illustrée par des solutions originales et récentes, ce rapport met en lumière les tendances, les stratégies et les modèles observés dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Plusieurs études de cas apportent des précisions sur la mise en œuvre de l’action des autorités publiques dans les différents contextes nationaux et sur les éléments déterminants du cadre juridique et institutionnel. Les pays étudiés sont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et le Portugal. Source: www.oecdbookshop.org |
Modernising Government
Durant les dernières décennies, la plupart des pays de l’OCDE ont mis en œuvre des réformes visant à moderniser et améliorer l’état. Malgré ces efforts, d’aucuns craignent que la confiance du public dans ses autorités ait diminué : une tendance qui va à l’encontre des pouvoirs publics qui s’efforcent de servir le public. Cette tendance soulève également la question : comment les autorités pourraient-elles renforcer la confiance et améliorer la performance ? Afin de se préparer pour le 21e siècle, les pays de l’OCDE doivent répondre à cette question. Dans cet esprit, les Pays-Bas ont le plaisir et l’honneur d’organiser cette réunion en collaboration avec la Direction OCDE de la Gouvernance publique et du développement territorial, « Renforcer la confiance dans l’action publique : Quel rôle pour l’état dans le 21e siècle ? » La réunion sera tenue le 28 novembre à Rotterdam. Ce site web fournit des informations sur le programme et l’organisation de la réunion, ainsi que de la documentation et de l’information destinées aux médias.
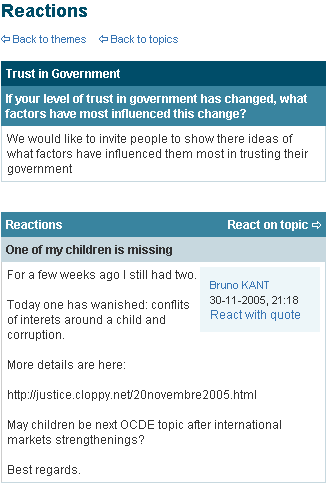
Point de vue du Canada
Le fonctionnaire qui accepte un bénéfice en échange de son influence, ne se rend pas nécessairement coupable de corruption. Les questions posées par les tribunaux sont les suivantes : la personne est-elle consciente qu'elle est fonctionnaire? Le fonctionnaire a-t-il demandé ou accepté le bénéfice en question de façon intentionnelle, pour lui-même ou pour une autre personne? Le fonctionnaire sait-il que la récompense est offerte en échange de son influence relativement au traitement d'affaires avec le gouvernement?Source: www.justice.gc.ca, l'abus de charge publique
L'Europe des ripoux s'élargit
Score CPI France 2001 : 6.7 Score relates to perceptions of the degree of corruption as seen by business people, academics and risk analysts, and ranges between 10 (highly clean) and 0 (highly corrupt). |
L'Europe des ripoux s'élargit
ONG et sociétés d'audit pointent du doigt, chez les entrants, le problème endémique de la corruption, minimisée par la Commission.
par Jean QUATREMER
QUOTIDIEN : mardi 27 avril 2004
Extraits :
Le mot à ne pas prononcer à Bruxelles, lorsque l'on parle des nouveaux Etats membres, est indubitablement: «corruption». Il a le don de faire sortir de ses gonds Günter Verheugen, le commissaire européen chargé de l'Elargissement, qui n'hésite pas à rappeler à son interlocuteur toutes les «affaires» qui éclaboussent régulièrement la France ou l'Allemagne.
Cette volonté de minorer un problème majeur dans une économie de marché obéit à une logique politique.
L'exécutif bruxellois sait parfaitement que la lutte contre la corruption dans ces pays prendra au moins des dizaines d'années avant d'être effective, puisqu'elle suppose la mise en place préalable d'un appareil administratif et judiciaire digne de ce nom, l'adoption d'une législation ad hoc et, enfin, une augmentation conséquente du salaire des fonctionnaires locaux.
«La lutte contre la corruption, c'est une affaire de culture. Ça prendra du temps», reconnaît-on à l'Olaf, l'Office antifraude de l'Union. Autrement dit, insister sur la corruption, c'était prendre le risque de reporter l'élargissement sine die.
«Galle verruqueuse». La Commission s'est donc contentée de traiter le problème sur le même mode que la mise aux normes phytosanitaires de la production laitière tchèque. Ainsi, dans son dernier «rapport global de suivi sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE» du 5 novembre 2003, il faut de bons yeux pour trouver mention de la corruption : citée dans «les domaines nécessitant des efforts accrus», elle vient bien après les retards dans la mise en place des organisations communes de marché dans le domaine agricole...
Risque réel. En fait, pour avoir une vision exacte de la gravité de la situation, il faut se tourner vers les ONG, comme Transparency International (à lire ici) ou l'Open Society Institute, les sociétés d'audit, les instituts de sondage ou encore la Banque mondiale qui a estimé le pot-de-vin moyen pour un juge en Slovaquie à 256 euros...
Fermer le robinet. Les fraudes qui ont lieu chaque année dans les Etats membres actuels montrent que, même avec un appareil d'Etat efficace, il est difficile, voire impossible, de les éviter. Et l'Olaf n'a pas les moyens humains pour pallier les défaillances des autorités locales.
iFRAP, du Société Civile N°7, janvier 2001, extraits : La corruption au coeur de la France Qu’est ce que la corruption ? Aussi bizarre que cela puisse paraître, la corruption n’est pas facile à définir. Où se situe la frontière entre la corruption et l’obligeance ? A partir de quel moment peut-on dire qu’il y a un corrupteur et un corrompu ? D’autant plus que ceux qui sont concernés appartiennent à toutes les sphères d’activité et disposent de tout un arsenal d’arguments pour soutenir que le corrompu ne s’est pas enrichi personnellement ou que les intentions du corrupteur n’étaient pas, à l’origine, de nature frauduleuse. Mais, quelles que soient ces querelles de nature linguistiques ou juridiques, il existe plusieurs définitions de la corruption. Pour la Commission des communautés européennes, « la corruption est liée à tout abus de pouvoir ou toute irrégularité commis dans un processus de décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu » (la Commission avait bien défini ce qui allait devenir un scandale en son propre sein). La définition donnée par le Groupe multidisciplinaire sur la corruption du Conseil de l’Europe est encore plus précise : « la corruption est une rétribution illicite ou tout autre comportement à l'égard des personnes investies de responsabilité dans le secteur public ou le secteur privé, qui contrevient aux devoirs qu'elles ont en vertu de leur statut d' agent d'Etat, d'employé du secteur privé, d'agent indépendant ou d'un autre rapport de cette nature et qui vise à procurer des avantages indus de quelque nature qu'ils soient, pour eux-mêmes ou pour un tiers ». De nombreux rapports considèrent que le phénomène de corruption se serait amplifié à cause de la décentralisation. Ce qui est sûr, c’est que la décentralisation a été mal faite. Les collectivités locales ont hérité de plusieurs missions sans avoir les moyens pour les accomplir et l’autorité locale s’est vu doter d’un pouvoir de décision important concentré entre quelques mains sans véritable contrôle. Les subventions versées à des associations ne sont pas plus soumises à des contrôles que les aides ou les prêts. Ces subventions peuvent être versées par l’organisme bénéficiaire à d’autres associations qui, à leur tour, peuvent les rétrocéder à d’autres entités juridiques ou à des sociétés commerciales. Certaines associations utilisent l'argent public pour verser à leurs salariés ou à des tiers des rémunérations occultes sous forme de primes ou d’indemnités (en espèces, en frais de déplacements fictifs ou de paiements sous forme de fausse facturation). La multiplication des affaires et le mauvais classement de la France dans les comparaisons internationales sur le degré de corruption de chaque pays ont poussé les autorités publiques à renforcer les mesures contre la corruption et à multiplier les services et les organismes en charge de cette lutte. Ainsi, à part la Cour des Comptes et les Chambres régionales des comptes dont le rôle est de dévoiler les affaires et non pas de punir les coupables, on peut compter sur le Service central de prévention de la corruption (SCPC), la Direction générale des Renseignements généraux (RG), la Direction centrale de la police judiciaire, l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Tous ces organismes dépendent de l’Etat et sont financés avec de l’argent public. |
November 25, 2005
Qu'est-ce que la protection de l'enfant ?
Protection de l'Enfant, Introduction,Extraits :
L'UNICEF est convaincu que la protection des enfants est essentielle à leur survie, leur santé et leur bien-être.
La maltraitance, l'exploitation et la violence - pour scandaleuses qu'elles soient - sont le plus souvent une affaire privée. Elles relèvent souvent du crime organisé et de la corruption. Les conséquences n'apparaissent qu'avec le temps : des enfants sans instruction, en mauvaise santé et appauvris.
L'UNICEF est convaincu que la responsabilité de s'assurer que les enfants sont en sécurité incombe à tout un chacun. Nous ouvrons de concert avec des particuliers, des groupes de citoyens, les gouvernement et le secteur privé en vue d'aider à créer des environnement protecteurs pour les enfants. En grandissant dans un milieu sain et stimulant, les enfants peuvent résister à la maltraitance et éviter l'exploitation. Un environnement soucieux de leur bien-être les fortifie contre tout ce qui peut leur nuire, de la même façon qu'une bonne nutrition et des soins de santé de qualité les fortifient contre la maladie.
Eva Joly, l'inflexible
Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ? Eva Joly, documentaire, société Extrait de la critique de bob morton du 30.09.2003 sur A Contre Sens : On ne se retrouve cependant pas devant un éventail de faits qui serviraient une généralisation puisque l'auteur - Eva Joly - cherche à nous montrer le fonctionnement du système dans sa globalité. Sans jamais sombrer dans le "trop technique", on comprend comment fonctionne cette face cachée du monde dans laquelle les puissants peuvent agir en toute impunité. Sur AIDH.org, l'envers des droits de l'Homme |
L'Express du 23/10/2003
La juge qui fit trembler les puissants est repartie en Norvège. Lassée? Oubliée? Le succès de son livre-manifeste contre la corruption prouve le contraire. Histoire d'une vie et d'une carrière menées comme un combat
Extrait :
On la porte aux nues ou on la déteste. Ses partisans louent son courage, ses détracteurs raillent sa mégalomanie. Pendant dix ans, elle a fait trembler le gotha de la finance, les politiques et les grands patrons. Pendant dix ans, elle n'a pas hésité à s'opposer à sa hiérarchie, à pourfendre ses collègues jugés trop timorés ou à se coltiner avec les avocats de ses mis en examen.
Cette femme au caractère bien trempé, auteur d'un best-seller - Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre? - vendu en trois mois à plus de 175 000 exemplaires, se nomme, on l'a deviné, Eva Joly. Juge d'instruction à Paris de 1992 à 2002, elle est devenue, aux yeux de l'opinion publique, le symbole du combat des petits, des laissés-pour-compte contre les puissants. Une sorte d'icône vivante de la justice. Jusqu'à ce que, au début des années 2000, on découvre que ses procédures laissent à désirer. Que certains de ses mis en examen - Loïk Le Floch-Prigent en sait quelque chose - ont été rudoyés au cours de leurs interrogatoires. La «jolymania» s'estompe. Et commence le temps des méchantes rumeurs distillées par ses détracteurs. On laisse entendre qu'elle serait à la solde d'une puissance étrangère. On murmure qu'elle serait à la tête d'une internationale de juges, chargée d'abattre le capitalisme. Sa vie privée n'est pas épargnée. Elle aurait, dit-on, des tas d'amants...
Eva Joly encaisse. Sans broncher. Finalement, au début de 2002, elle se rend compte qu'il lui faut changer d'air. Alors, elle choisit de retourner vers la mère patrie: la Norvège, où elle est née il y a cinquante-neuf ans. Donc, Eva part pour Oslo, où elle vient d'être promue conseillère du gouvernement pour la lutte contre la corruption. Un poste sur mesure, fort bien rémunéré.
Rapport SCPC 2001, fiche pratique...
Extraits significatifs du chapitre 7...La prise illégale d’intérêts est « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. ».
Il s’agit simplement de préserver : d’une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage « nul ne peut servir deux maîtres à la fois » et d’autre part, d’écarter tout soupçon que l’administré pourrait avoir. En effet, il est toujours à craindre qu’une personne investie d’une fonction publique ne puisse apporter la même attention et la même indépendance d’esprit, à une entreprise dans laquelle elle aurait elle-même ou par personne interposée quelque intérêt.
La prise illégale d’intérêts est une infraction à caractère objectif, dont la réalisation ne nécessite aucune intention frauduleuse. Les intéressés « ne peuvent pas ne pas savoir » dit la jurisprudence. Cette intention frauduleuse de tout délit est ici réduite au simple fait que le coupable ait pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance.
Extrait des conditions de poursuites, au chapitre 7 :
Lorsque la prise illégale d’intérêts a été dissimulée derrière une façade licite, le juge répressif peut reporter le point de départ de la prescription au jour où les actes délictueux sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
November 24, 2005
CHAPITRE Ier. - La méthodologie
Le service a élaboré une analyse des fraudes qui permet de remonter jusqu’à la corruption (il peut y avoir fraude sans corruption mais il ne peut y avoir de corruption sans fraude) à partir d’un triple constat :- la plupart des organisations (entreprises comme administration) sont soumises à de nombreux contrôles depuis le contrôle de premier niveau jusqu’aux contrôles externes ;
- chacun de ces contrôles est structuré autour de procédures spécifiques et de ses objectifs. Souvent l’échange d’information entre ces différents contrôles pose problème ;
- les montages qui supportent la fraude et la corruption sont de mieux en mieux organisés ; plus techniques, plus complexes, ils utilisent de plus en plus souvent des vecteurs inédits.
L’analyse des risques doit être adaptée au caractère évolutif de cette situation. C’est dans cet esprit qu’a été élaborée la méthode du SCPC. Partant de là, les formations qu’il assure ont deux objectifs principaux : prévenir l’apparition de la corruption dans les organisations (publiques ou privées) et aider les contrôleurs à détecter la fraude et la corruption. Elle s’appuie sur une méthode : l’analyse des risques.
Rapport 2000 du SCPC
Un article (cf. note 42) de Claire BRISSET, montre l’étendue du fléau de la corruption dans le domaine de l’adoption internationale. Il n’est pas rare de voir de faux jugements, des accords dans lesquels le consentement est vicié ou des enfants purement et simplement donnés contre l’avis de la famille en échange de fortes sommes d’argent. Selon une étude de l’UNICEF menée dans 5 pays européens, aux Etats-Unis et au Canada, « 23000 enfants en provenance de nations démunies ont été adoptés en 1997, contre 16 000 quatre ans plus tôt ». Les intermédiaires chargés de ces adoptions agences, conseils, pourraient gagner jusqu’à 150 000 F par dossier d’adoption. Dans certains pays, des médecins, du personnel médical ou même certains individus sans compétence particulière peuvent intervenir dans l’adoption. La DDASS, la MAI et les associations d’adoption agréées mettent pourtant en garde les futurs adoptants sur les dérives possibles par la voie du recueil direct. « Il s’agit là d’une démarche à hauts risques qui doit être formellement déconseillée parce qu’elle fait très souvent jouer des considérations d’ordre pécuniaire et qu’elle expose les adoptants à d’éventuelles pressions psychologiques ainsi qu’à de possibles complications sur le plan légal tant en France qu’à l’étranger (cf. note 43) ». La mission qui a été confiée au SCPC par le législateur est l’analyse des modes opératoires de la corruption pour en démonter les rouages, en démêler les réseaux et en déjouer les manœuvres. Pour sophistiqués qu’ils soient en apparence, les schémas frauduleux n’en restent pas moins répétitifs dans leur mise en œuvre, ordinaires dans leur logique et communs, quels que soient les secteurs économiques concernés. Les études déjà réalisées par le service portant sur des domaines aussi variés que le sport, les marchés publics, les secteurs de la santé, la formation professionnelle, le domaine du commerce international, etc., le démontrent amplement : la récurrence des techniques en est un des indices. C’est pourquoi le SCPC vise à divulguer ces procédés pour que décideurs et enquêteurs, acteurs publics et privés, contrôleurs et contrôlés puissent disposer de moyens objectifs et efficaces de déceler les risques et de contrer la corruption. Mais l’outil n’est qu’un moyen. Encore faut-il la volonté de s’en servir, donc la conscience des ravages causés par la corruption et de la nécessité de la combattre, même parfois au risque de son confort personnel. |
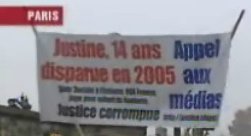
« C'est un secteur potentiellement créateur de nombreux emplois (450 000 selon le Plan), à condition que soit proposé un statut suffisamment attractif. »
Voir Risque d´arbitraire pour 450 000 enfants