April 1, 2006
Des arbitres de football corrompus, mais justes !
Un certain travail peut être accompli même si le dossier d'assistance éducative n'est pas accessible aux parents : brouillon.pdf et ses pièces jointes, brouillon.zip.
March 29, 2006
Article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles
Je comprend de mieux en mieux pourquoi le juge pour enfants ne m'a pas accordé l'accès au dossier qui doit être vide... |
Guide pratique inter-institutionnel
du signalement
à l’usage des professionnels.
2004
Ces mesures nécessitent l’adhésion de la famille. L’accord des parents peut être suscité mais il ne peut être présumé. Il doit être formalisé par l’acceptation écrite d’une mesure d’aide contractualisée.
Lorsque l’évaluation met en évidence des éléments de gravité du danger encouru par l’enfant et en cas de révélation d’abus sexuels ou lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures autoritaires parce que les parents refusent de coopérer à la mise en place d’une mesure de protection contractualisée, l’autorité administrative saisit l’autorité judiciaire et lui communique l’ensemble des éléments qu’elle a pu recueillir. Elle l’informe également des mesures qu’elle a déjà exercées.
L’article L.226-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance, le Président du Conseil général avise sans délai l’autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés. »
Instruction interministérielle cabinet/DGAS n° 2001-52 du 10 janvier 2001
relative à la protection de l'enfance
...
Loi n° 89-484 du 10 juillet 1989 (voir les articles L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, anciens articles 68 et 69 du CFAS)
De la prévention à la protection,
un département mobilisé
En réaffirmant le droit des usagers, la loi du 2 juillet 2002 souligne leur capacité à être acteurs de leur vie. Toutes ces actions s’inscrivent dans un accompagnement des familles visant, non pas à « faire à la place des parents » mais avec eux.
La prévention fait partie intégrante de la protection de l’enfance. Elle est encadrée par la loi du 10 juillet 1989 qui demande aux Conseils généraux de « mener des actions de prévention à l’égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire. »
Pour Dominique Le Clerc, directeur adjoint du développement social et de la solidarité en charge de l’entité enfance famille, « notre coeur de métier c’est le lien parent-enfant. »
March 28, 2006
Un rapport blâme le fonctionnement d'une structure
Censé accueillir en urgence et protéger les mineurs en danger, le Foyer de l´enfance des Alpes-Maritimes (FEAM), structure du conseil général, serait une institution «maltraitante», selon quatre magistrates de Grasse. «Emues, choquées et scandalisées», trois juges des enfants et une substitute dénoncent un «fonctionnement délétère» dans un rapport confidentiel du 17 septembre, révélé récemment par Nice-Matin.Christian Estrosi, président UMP du conseil général, en charge du FEAM qu´il subventionne à raison de plus de 15 millions d´euros annuels, assure : «C´est un constat que je partage pour l´essentiel. Cette situation est inacceptable.» Christian Estrosi a demandé au ministre de la Santé le départ du directeur, dont il déplore «un manque d´autorité hiérarchique». «Ce qui est dit dans le rapport est vrai à 90 %», affirme de son côté Jean-François Knecht, conseiller général PS, qui s´interroge sur d´éventuelles suites pénales.
Mais le directeur réfute les accusations de violences, de maltraitance et de privations, d´un rapport «non contradictoire, basé sur la parole d´enfants» qu´il estime «fait pour salir le foyer et [le] faire partir». Il reconnaît toutefois que «tout n´est pas faux dans le rapport», et attend sa mutation : «Je ne peux pas rester.»
«Coups». Sur les 18 centres d´accueil du FEAM, certains laissaient à désirer lors des visites des magistrates menées, sans prévenir, entre 2003 et 2004, si on en croit leur récit. Le foyer l´Auda (Nice) a des locaux «comparables à un squat» et donne «une impression de total dénuement». Au Poulido (Vence), un chef de service convoque des ados dans son bureau, «les plaque au mur et leur donne des coups de poing». Trois ados affirment y avoir subi des fessées publiques, «contraints, fesses nues, et devant les autres, de subir les coups». Pour l´équipe éducative, il faut «prendre beaucoup de distance quant à la parole de "ces enfants"», décrits comme «pervers» et «susceptibles de manipulation». Le directeur réfute ces faits : «S´ils avaient vraiment eu lieu, pourquoi ne pas m´avoir interpellé ?»
A la Palombière (Cap-d´Antibes), l´absence de propreté est «affligeante» et les ados «disent avoir faim». Les éducateurs confirment : ils prennent un second repas en rentrant chez eux après 22 heures. Le directeur conteste : «Un ado, quand vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas, il va dire "y a rien à manger".» Un mineur y raconte une activité : «L´éduc´ nous met dans le Trafic, on fait la route du bord de mer en camionnette, et on rentre. Ça ne dure qu´un quart d´heure.»
Les magistrates ayant «ressenti un vif sentiment de culpabilité» ont prononcé, dès le lendemain, des mainlevées de placement ou envisagé des réorientations. La Palombière a depuis été reprise en main. A Clair Castel (Antibes), une fille de 6 ans, dont «l´état de santé avait été négligé gravement pendant plusieurs heures», a été hospitalisée pour une péritonite aiguë. Aux Corallines (Cagnes-sur-Mer), une victime d´inceste arrivée de nuit est «reçue par un veilleur de nuit et laissée seule sur un matelas».
Sorcières. Au final, l´Auda (fermé depuis) et la Palombière sont «totalement insalubres». Ailleurs, les magistrates dénoncent «un vide éducatif, une absence de compassion», des enfants «considérés comme des objets», et des règles conçues «dans le souci exclusif du fonctionnement de l´institution, plaçant volontairement au second plan l´intérêt et le bien-être des mineurs». Le rapport a été transmis au parquet général d´Aix-en-Provence. Au FEAM, la CGT craint pour l´emploi des 400 salariés, car Estrosi veut réduire la capacité d´accueil de 240 à 190 places. Le syndicat, qui dénonce «la chasse aux sorcières» et «la volonté de privatiser», met en doute le rapport des juges.
www.bouclier.org,
article de Libération du 6 janvier 2005
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LA GESTION DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DES ALPES-MARITIMES Années 1997 à 2002 |
March 19, 2006
Trop longue, trop chère, trop obscure
Les syndicats de magistrats réclament plus de collégialité et d'indépendanceLE MONDE, 17.03.06
"Il faut dire aux citoyens que l'état de la justice française est bien pire que ce qu'ils imaginent, a souligné le président de l'USM, Dominique Barella. Nous avons tous compris le message des citoyens, qui trouvent que la justice est trop longue, trop chère, trop obscure. En plus, ils n'y croient plus. Nous attendons les moyens matériels et juridiques de bien exercer notre métier."
De son côté, Côme Jacqmin, secrétaire général du SM, a achevé de présenter les propositions de son syndicat en affirmant : "L'affaire d'Outreau pourrait devenir une chance paradoxale : une occasion pour le législateur de faire qu'une autre justice soit possible, en lui donnant les moyens de retrouver et d'inspirer une confiance sans laquelle il n'est pas d'Etat de droit."
Ce n'étaient que quelques claques
«Si on balance, on plonge» «Si c'était une enquête judiciaire encore... Mais c'est administratif. Il est hors de question que je dénonce ça et que je balance des collègues. Si on dit, on plonge. Ou on est placardisé, muté...» |
«Tortures» policières: ce n'étaient que quelques claques
par Patricia TOURANCHEAU
Libération samedi 18 mars 2006
La police des polices rejette les révélations du livre «Place Beauvau» sur les interrogatoires très musclés d'islamistes lors de la campagne d'attentats de 1995.
Questionné par les journalistes sur les sanctions envisagées, ce directeur de l'instance disciplinaire de la police a rétorqué que «les gifles constituent des faits tout à fait illégaux, donc l'IGPN les réprouve... Nous n'avons pas parlé de généralisation de ces procédés, ni de passage à tabac», a-t-il distingué en ajoutant : «Des suites seront données.»
Panorama des droits de l’enfant en France Quelles interrogations pour la pratique professionnelle ? oasismag, vendredi 21 janvier 2005 Progressivement depuis le dernier quart du XIXème Siècle, l’enfant a fait l’objet d’une réelle prise en considération. Il est devenu un sujet à part entière qui demande une protection de l’Etat en cas de défaillance de la famille ou de tout groupe dans lequel il est susceptible de vivre. - Non discrimination (art.2 de la CIDE). - Respect de l’opinion de l’enfant. - Protection de l’identité. - Libertés religieuses. - Education. - Loisirs et activités culturelles. ... 3. La santé des jeunes |
March 18, 2006
Une nouvelle réforme en chantier
En réponse à l'article qui suit, dans le blog de l'un des principaux contributeurs : > Je l'ai déjà démontré mille fois > comme j'ai dit mille fois que l'Aide sociale > à l'enfance avait encore l'image de > l'Assistance publique de jadis qui lui > collait à la peau. Je suis navré de ne pas partager votre sentiment et tout autant navré encore de disposer un dossier de plus de 500 pages qui fait apparaitre que des travailleurs sociaux et des juges peuvent encore s'en tenir aux textes et pratiques de 1889, aujourd'hui, en l'an 2006. Non seulement je peux établir cela, je peux encore montrer qu'il peut y avoir collusions et corruption dans l'intérêt de tiers, au parfait mépris d'une famille et de ses enfants (dont un nourrisson). J'ai cependant de l'estime pour de nombreux acteurs et travaux auxquels je me réfère d'ailleurs moi même, depuis des lustres, tout en étant systématiquement boudé par les institutions, du simple fait que les travailleurs sociaux ainsi que les juges, dans leur ensemble, jouissent d'une certaine réputation. Je dispose de preuves et le tout est bel et bien du domaine du possible: «Dans le dossier, des choses n'allaient pas» Extraits des témoignages des deux journalistes de «Libération» qui ont suivi l'affaire. par Jacqueline COIGNARD Libération, mercredi 15 mars 2006 C'est sur l'aire d'autoroute que j'arrive enfin à joindre les gens de l'aide sociale à l'enfance. Un cadre haut placé. Il me dit: "Ce sont les enfants qui, dans un cadre familial nouveau, chez leur assistante maternelle, découvrent une vie paisible et s'étonnent que cette vie familiale soit la norme. Et commencent à parler... Et pour moi, une assistante maternelle, une aide sociale à l'enfance, sont des gens de confiance. Je dirai même qu'ils parlent ma langue." Le doute s'efface à ce moment-là. Aujourd'hui je n'attend plus rien sinon ce 30 mars prochain pour une ultime audience auprès de la cour d'appel de Versailles. Avec ma plus haute considération. |
Protection de l'enfance : une nouvelle réforme en chantier
LE MONDE | 16.03.06 | 13h38 • Mis à jour le 16.03.06 | 13h38
Il y a un peu plus de vingt ans, les grandes lois de décentralisation du premier septennat de François Mitterrand confiaient la protection de l'enfance aux départements. Contrairement à ce qu'annonçaient les oiseaux de mauvais augure, les conseils généraux choisissaient d'investir massivement : en vingt ans, les dépenses ont plus que doublé. Avec un budget de 5,4 milliards d'euros en 2005, l'aide sociale à l'enfance est devenue le premier poste de dépenses des départements en matière d'action sociale. "Parce que la protection de l'enfance est un domaine particulièrement sensible qui constitue leur première mission en matière de solidarité, les départements s'y sont fortement impliqués", résumait, en novembre 2005, l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS).
Philippe Bas, ministre délégué à la famille, devait rendre publiques, jeudi 16 mars, les grandes orientations de sa réforme de la protection de l'enfance, qui doit être présentée en conseil des ministres à la mi-avril.
Car, pendant ces vingt ans, cette politique a essuyé bien des tempêtes. Elle a subi de plein fouet les ravages du chômage de masse, qui ont précarisé des milliers de familles et d'enfants, mais elle a également été ébranlée par l'émergence, dans les années 1980, du débat sur la délinquance sexuelle. " Avant, on parlait des "cas sociaux", on se souciait des enfants sous-alimentés ou battus, mais on ne parlait jamais ou très rarement de viols ou d'attouchements, raconte le directeur de l'Observatoire de l'enfance en danger (ONED), Paul Durning. A partir de 1985, la mobilisation des mouvements féministes contre l'inceste et les travaux réalisés en Europe du Nord, aux Etats-Unis et au Canada sur le traumatisme subi par les enfants abusés ont permis de placer cette question au centre du débat public."
Aujourd'hui, 270 000 enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Certains ont été gravement maltraités par leurs parents, d'autres sont en danger auprès d'une famille qui traverse une passe difficile. Ces jeunes connaissent des destins très divers : la moitié d'entre eux quittent leur famille pour vivre dans un foyer, un internat ou une famille d'accueil, tandis que les autres restent auprès de leurs proches, soutenus par un suivi psychologique, une aide à la gestion du budget ou des visites régulières d'éducateurs.
Depuis le rapport publié en 1980 par Jean-Louis Bianco et Pascal Lamy sur l'avenir de l'aide sociale à l'enfance, les textes encouragent fortement le maintien des jeunes dans leurs familles. "La priorité n'est plus, comme au début de l'aide aux familles et aux enfants en difficulté sociale, de séparer l'enfant de sa famille pour le protéger mais d'essayer d'éviter cette séparation en aidant préventivement les parents", résumait, dans un rapport de 2001, le directeur de l'enfance et de la famille de Seine-Saint-Denis, Claude Roméo. Ces orientations, consacrées par la loi de 1984, ont profondément bouleversé les pratiques de l'aide sociale à l'enfance : en quatre ans, de 1982 à 1986, le nombre d'enfants placés a chuté, passant de 183 000 à 147 000.
La protection de l'enfance n'a pas failli, mais la persistance de la crise économique et les dégâts durables de l'exclusion sociale rendent son travail de plus en plus difficile. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui consacre un très gros budget à l'aide sociale à l'enfance (190 millions d'euros), 5 000 enfants sont, tous les soirs, considérés comme SDF. "Leurs familles s'adressent à nous parce qu'elles n'ont pas d'hébergement fixe, raconte M. Roméo. Les parents vivent avec leurs enfants dans des hôtels sociaux, des meublés, des voitures, des domiciles de voisins. Tous les soirs, dans ce département, ce sont plus de 2000 familles qui sont hébergées en urgence."
Face à ces situations de crise, les moyens, notamment dans le domaine de la pédopsychiatrie, n'ont pas toujours suivi. La Seine-Saint-Denis ne compte ainsi que dix lits d'hospitalisation pour adolescents, alors que l'aide sociale à l'enfance estime que 130 enfants du département devraient en bénéficier. En 2004, 4 000 enfants orientés en pédopsychiatrie n'ont pas pu obtenir un suivi faute de place. "C'est pourtant à ce moment-là, en amont, qu'il est utile d'agir, regrette Marie-Rose Moro, la chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Avicenne, à Bobigny. La protection de l'enfance commence dès qu'il existe des souffrances au sein de la famille."
Plus encore que la pauvreté, c'est aujourd'hui l'isolement social qui fragilise, selon le dernier rapport de l'ODAS, la situation des familles (Le Monde du 3 novembre 2005). "Grâce aux minimas sociaux, et notamment au RMI, les problèmes de pauvreté stricto sensu sont moins lourds que dans le passé, estime le délégué général de l'Observatoire, Jean-Louis Sanchez. L'immense majorité des enfants ont désormais à manger tous les jours, ce qui est un immense progrès, mais l'inoccupation des parents est préoccupante : les liens sociaux sont rompus, l'exclusion est en marche, et les enfants sont parfois en danger."
Dans les années à venir, l'aide sociale à l'enfance devra sans doute apprendre à intervenir plus fréquemment en amont. "La mission de prévention confiée aux conseils généraux ne vise que les mauvais traitements à l'égard des mineurs alors que l'ensemble des enfants susceptibles d'être mis en danger doivent être protégés", relevait, en 2005, la mission sur la famille de l'Assemblée nationale présidée par Patrick Bloche (PS), dont la rapporteure était Valérie Pecresse (UMP). Repérer les difficultés dès la grossesse, sensibiliser tous les professionnels en contact avec les enfants à la protection des mineurs, renforcer la présence de médecins et d'infirmières dans les écoles : ces orientations préconisées ces dernières années par plusieurs rapports ont été reprises par Philippe Bas.
L'aide sociale à l'enfance devra également inventer des formes éducatives nouvelles. "Pendant longtemps, la prise en charge des enfants en danger a été limitée à la simple alternative : mesure éducative au domicile familial ou placement", regrettait, en 2005, le premier rapport de l'ONED. Sans même attendre de nouveaux textes, les équipes ont créé, ici et là, des solutions innovantes : des relais parentaux qui accueillent les enfants pendant quelques jours ou quelques semaines le temps que les parents surmontent des difficultés passagères ; des accueils de jour qui prennent en charge les jeunes pendant la journée, le mercredi ou le week-end, tout en réalisant des entretiens avec les parents ; des accueils "séquentiels" qui hébergent des enfants en soirée ou le week-end lorsque le séjour à la maison est trop éprouvant et le placement inutilement brutal.
C'est ce que propose, par exemple, Le Clair Logis, une maison d'enfants, dans le 18e arrondissement, à Paris. "Même s'il faut parfois éloigner les enfants pour les protéger, la séparation reste un traumatisme, explique son directeur, Yves Masson. Ici, nous avons créé un système très souple qui permet d'épouser au plus près les évolutions de la vie de famille. Lorsque les tensions sont fortes, nous accueillons l'enfant, mais si les relations s'apaisent, nous tentons un retour au foyer. Au lieu de subir les décisions des professionnels, la famille redevient un véritable acteur." Le projet de M. Bas encourage ces nouvelles formes éducatives.
Anne Chemin
Article paru dans l'édition du 17.03.06
Le Figaro, La protection de l'enfance à l'heure des départements Delphine de Mallevoüe 17 mars 2006, rubrique France, extrait : Cette mise en retrait de la justice fait d'ores et déjà grincer quelques dents, notamment chez les avocats et les magistrats qui voient leur intervention amoindrie. «Nous sommes très inquiets, confie Dominique Attias, avocate spécialisée à Paris. En donnant les pleins pouvoirs aux départements on supprime le contre-pouvoir qu'exerçait l'instance judiciaire. C'est très dangereux.» L'Expressdu 27/09/2004 Enfance maltraitée Une priorité par Marie Huret En matière de prévention et de protection, beaucoup reste à faire. Le gouvernement passe à l'action C'est toujours la même stupeur: comment personne n'a-t-il rien vu? Rien empêché? A Drancy, le 5 août, la police découvrait cinq enfants, âgés de 14 mois à 7 ans, sous alimentés et nus comme des vers dans un appartement jonché de cafards. Le 18 août, cette fois à Bourges, une mère célibataire de 23 ans était jugée en comparution immédiate: depuis plusieurs semaines, son fils de 3 ans vivait plongé dans l'obscurité, au milieu des bris de verre et des excréments. Chaque fois, les parents n'étaient pas inconnus des services sociaux, qui ont tardé à intervenir. Chaque fois, la chaîne de protection s'est enrayée. |
March 10, 2006
L'Etat verse un pactole aux banlieues
Le Figaro, 09 mars 2006, (Rubrique France)Par Cécilia Gabizon, extraits :
VILLE Après les émeutes de novembre, près de 1,2 milliard d'euros sont débloqués en 2006. Avec un objectif : éviter les saupoudrages.
Critères d'évaluation
La fin annoncée du saupoudrage reste cependant soumise aux aléas politiques. Jean-Louis Borloo avait réduit le fonds de soutien aux associations lorsqu'il était ministre de la Ville, préférant augmenter, via la dotation de solidarité urbaine (DSU), le budget des villes pauvres, pour qu'elles gèrent seules leurs besoins. Avec cette nouvelle péréquation, Clichy-sous-Bois a ainsi touché 1,9 million d'euros en 2004, puis 5,9 en 2005, et recevra presque 10 millions en 2009. L'ensemble des villes pauvres ont vu leur DSU fortement augmentée. Mais beaucoup ont financé leur fonctionnement plutôt que des associations... Et Dominique de Villepin a finalement annoncé, en plein embrasement des banlieues, le rétablissement d'une subvention supplémentaire de 100 000 euros à nouveau gérée par l'État !
Mais cette fois le gouvernement veut fixer les critères d'évaluation des associations pour éviter la gabegie et la dilution des moyens. Il envisage de confier les audits à des sociétés privées. Une petite révolution. Reste à savoir si ces moyens inédits suffiront pour remédier aux problèmes désormais structurels du chômage de masse et de la paupérisation d'une partie de la population.
January 28, 2006
Caricaturé à loisir
"Mon client a été caricaturé à loisir"LE MONDE | 27.01.06
Me Caroline Matrat-Maenhout, l'avocate de Thierry Dausque, a été entendue par la commission jeudi 19 janvier.
Extrait de son audition.
Thierry Dausque, c'est l'illustration de la justice des pauvres. J'ai été commise d'office en février 2002. Mon client a été mis en examen et placé en détention en mars 2001. Pendant plus d'un an, il a été seul, sans famille, sans avocat. Nos confrères ne peuvent pas toujours assumer la défense dans le cadre de la commission d'office.
Je vais le visiter. Il me parle d'un épisode particulièrement traumatisant : sa confrontation, seul, face à ses trois accusateurs assistés de leurs avocats, au juge et à son greffier. Il a toujours souhaité un avocat. Il était seul ce jour-là. Thierry Dausque, c'est celui qui n'intéressait personne. On l'a caricaturé à loisir : un chômeur connu pour ses excès de boisson, donc forcément quelqu'un qui avait violé des enfants. Il ne parlait pas la même langue que les gens qui le questionnaient. Il est important que la magistrature se mette à la portée des gens. Le président de la cour d'assises (du Pas-de-Calais) m'est apparu comme un théoricien, pas comme quelqu'un qui avait le souci des gens.
L'inquisition, Dominique et les dominicains, extraits : Il faut d'abord dire qu'il y a deux Inquisitions, ou mieux, deux vagues d'Inquisitions, assez différentes d'origine et de destin. La première, au XIIIe siècle, est l'aboutissement d'un long processus, mis en oeuvre par les Papes: on l'appelle souvent "Inquisition pontificale" . La seconde répond à une initiative des Rois catholiques espagnols qui, en 1478, demandent au Pape de réorganiser l'ancienne institution. Cet instrument de l'absolutisme royal, dirigé contre les minorités religieuses juives et musulmanes mal assimilées, et contre les courants de pensée qui semblent menacer l'ordre social, ne sera supprimée qu'au XIXe siècle. C'est elle qui fait l'objet d'une "légende noire" assez tenace pour qu'encore aujourd'hui le terme d'Inquisition, dans la mentalité générale, évoque immédiatement de façon quasi-affective les idées de fanatisme et d'intolérance. Les rois d'Espagne firent souvent appel à des dominicains comme Thomas de Torquemada, mais, le plus souvent, dès la fin du XVIe siècle, à des jésuites. Le choix de la personne qui sera juge de la foi est d'autant plus important aux yeux du pape Grégoire IX qu'il redoute le danger d'un juge trop dépendant du prince, au service duquel il risquerait de mettre son office. Ce ne sont pas les inquisiteurs qu'il faut rendre responsables de la création de l'Inquisition. Si certains ont été déséquilibrés par le pouvoir redoutable qui leur était échu, comme le trop célèbre Robert le Bougre, nommé en 1235, qui se déshonora par ses excès dans le nord de la France, la plupart ont rempli avec compétence, indépendance d'esprit et souci principal du salut des âmes la tâche de juge qu'on leur confiait, à la nécessité salutaire de laquelle ils croyaient, comme la grande majorité des chrétiens d'Occident. Le problème de l'Inquisition s'inscrit dans deux problèmes bien plus anciens: celui de la poursuite de l'hérésie dans la société chrétienne et, plus généralement, celui de la sensibilité de cette société au dissentiment dans la foi. Cette dernière donnée remonte aux origines de l'Eglise, où les chrétiens s'attachent intensément au "sentiment de l'unanimité" (Philippiens 2, 2): "Un seul Seigneur, une seule foi, un seul, baptême, un seul Dieu et Père" , dit saint Paul (Ephésiens 4, 5). Certes, la foi est un don total de la personne à Dieu; mais elle comporte, pour être authentique, une croyance, un contenu objectif commun. C'est la société occidentale, ecclésiastique et politique, qui porte la responsabilité d'avoir créé et perfectionné l'Inquisition, par une longue suite de décisions de toutes sortes. L'inquisition médiévale, extraits : Avant l'Inquisition L'Inquisition est instituée en 1231 par Grégoire IX. L'hérésie et les ennemis de la foi étaient déjà poursuivis à cette époque. Les textes étaient : • les décrets de Latran II (1139) • la décrétale Ad adolendam de Lucius III (1184) • la décrétale Vergentes in senium d'Innocent III (1199) • les décrets de Latran III (1215) La procédure inquisitoire Il y a deux procédures principalement, l'enquête générale ou la citation individuelle. L'enquête générale consiste à convoquer la population entière d'une région. La citation individuelle se fait par le biais du curé, celui qui refuse de comparaître est excommunié. Le suspect interrogé doit jurer de révéler tout ce qu'il sait sur l'hérésie. Un notaire est chargé de noter les réponses. Les inquisiteurs peuvent recourir à des délateurs, à l'incarcération ou encore à la torture — son usage est légitimé (à condition qu'il n'y ait pas mutilation définitive des membres) par Innocent IV dans sa bulle Ad extirpenda en 1252. À défaut d'aveux, la preuve peut être apportée par des témoins, qui ne sont pas connus de l'accusé. Les protections accordées aux accusés sont très minces. Par exemple, des témoins habituellement rejetés par le tribunal (excommuniés, voleurs, personnes de mauvaises vie) peuvent être entendus contre le suspect. Par ailleurs, le suspect ne peut pas être assisté par un avocat ou un conseil. Les tentatives de papes comme Clément V pour imposer un traitement plus équitable seront ignorées. Les tortures sont parfois si violentes que même les gouvernants les dénoncent : Philippe le Bel se plaint en 1297 (même s'il a fait torturer lui-même les Templiers). Une personne déjà jugée n'est pas à l'abri pour autant : à tout moment l'Inquisition peut rouvrir un dossier. Néanmoins, il y a une possibilité de recours. Le traditionnel appel au Pape est dénié par Excommunicamus, mais dans la pratique, ils étaient fréquents. Même la mort n'empêche pas la procédure : parfois, les poursuites ont lieu même contre des gens qui sont déjà morts. Leur cadavre est alors brûlé. Peines encourues L'Inquisition n'administre pas réellement de peines, mais des pénitences. Les moins graves, appelées pénitences arbitraires, sont imposées par les inquisiteurs. Elles sont les seules infligées à ceux qui se sont présentés dans les temps (ce qu'on appelle « pendant le temps de grâce »). Ce sont la fustigation au cours de la messe, les visites aux églises, les pèlerinages, l'entretien d'un pauvre, le port de la croix sur les vêtements. La peine normale de l'hérétique converti est la peine de prison à vie, souvent réduite par l'inquisiteur, qui a le droit de moduler les peines. Il y a deux modes, le « mur large », et le « mur étroit », beaucoup plus sévère (réclusion solitaire). Il faut noter que la prison comme peine est pratiquement inconnue avant cette époque, c'est une nouveauté dans l'histoire de la justice. L'hérétique obstiné ou relaps est abandonné à l'autorité séculière qui les condamne au bûcher. Cette peine reste exceptionnelle (Bernard Gui en prononce 40 dans toute sa carrière). Elle a pour avantage de ne pas laisser de reliques aux partisans des brûlés. Les peines les plus graves entraînent la confiscation des biens du coupable au profit de l'autorité chargée des dépenses de l'Inquisition, d'où une certaine tendance à s'en prendre aux gens riches. L'Inquisition n'a pourtant pas fait fortune : ses dépenses sont considérables, et ses gains restent modestes. Saint Louis, Roi de France (1226-1270). Pénétré de ses devoirs de chrétien envers le peuple que la Providence lui avait confié, Saint-Louis s’attacha particulièrement à ce que la Justice fût rendue le plus exactement possible dans le royaume. Tous les historiens s’accordent sur ce point. Maintes fois il advint qu’en été il allait s’asseoir au bois de Vincennes après sa messe, et s’accotait à un chêne, et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans empêchement d’huissier ni d’autre. Et alors il leur demandait de sa propre bouche; «Y a-t-il ici quelqu’un qui ait partie?» Et ceux qui avaient partie se levaient. Et alors il disait: «Taisez-vous tous, et on vous expédiera l’un après l’autre». Établissements de Saint-Louis. L’an de grâce 1270, le bon Roi Louis ordonna ces établissements, avant qu’il n’allât à Tunis, en toutes les cours et prévôtés de France. Ces établissement enseignent comment tous juges doivent ouïr, juger et terminer toutes querelles qui sont traités devant eux. Matthieu 6 v 24 - Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, et Jésus de préciser: vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon. Mamon est un mot araméen qui signifie "richesse" et il indique biens pas seulement argent. Le terme "Mamon" est utilisé par Jésus pour indiquer la personnification de la richesse gagnée mal. Jésus ne condamne pas la richesse en soi même, mais parce qu'elle tend à devenir une idole, qu'il est adoré et servi à la place de Dieu( Mt 6,24), elle absorbe énergies physiques et spirituelles, elle rend sourd au rappel du Royaume et aux nécessités des frères( Cfr Lc 16,19-31). [...] Le discours sur la richesse permet à Jésus enfin de souligner aussi les reflets de bonté sociale demandés par la conversion à l'Évangile. |
December 23, 2005
Tricher est une chose permise
Transparency International a rendu un rapport qui montre que la corruption ne se cantonne pas aux pouvoirs politiques ou financiers mais touche aussi d'autres systèmes.Ce document de 85 pages a été réalisé à partir d'exemples pris dans dix pays : Argentine, Brésil, Mexique, Nicaragua, Bosnie-Herzégovine, Sierra Leone, Niger, Zambie, Géorgie et Népal.
Extrait du Monde du 9 décembre 2005 :
"Un manuel scolaire de base et une bonne note ne devraient pas dépendre du fait que l'on ait graissé la patte d'un enseignant ou d'un administrateur corrompu", s'indigne Huguette Labelle, la présidente de TI, en présentant une étude de TI intitulée "L'avenir dérobé – la corruption dans les classes d'école". "Pour les Libération, le 9 décembre 2005 Monsieur l'instituteur, je vous ai apporté un pot de vin L'ONG qui conclut sur un rappel aux « valeurs d'intégrité, d'équité et de bien public » et la confiance dans le gouvernement « nécessaire pour le développement économique et social », donne d'édifiants exemples de corruption en milieu éducatif. C'est d'abord le marché aux diplômes et aux bonnes notes dans les campus bosniaques, mais aussi l'école gratuite devenue payante au Mexique tant les dessous de tables sont généralisés. L'ONG évoque également les municipalités pauvres du Brésil, dont près de 55 % des subventions fédérales pour l'éducation s'évaporent chaque année à cause des fraudes. |
Grave atteinte au crédit et à la réputation de la police nationale
SAINT-ETIENNE (AP), le 23 décembre 2005 - La révocation d'un couple de policiers stéphanois qui, parallèlement à leur activité, dirigeaient une boîte de nuit dans cette ville a été confirmée vendredi par le tribunal administratif de Lyon.Les sous-brigadiers Alain Lorenzon, 35 ans, et Sylviane Lorenzon, 44 ans, qui estimaient que le ministère de l'Intérieur avait commis une "erreur manifeste d'appréciation" en les révoquant le 6 décembre 2004, ont été déboutés par la juridiction administrative qui les condamne par ailleurs à verser chacun 500 euros à l'Etat au titre des frais de justice.
Dans sa décision, le tribunal suit les conclusions du commissaire du gouvernement qui, le 24 novembre dernier, avait considéré que "le couple assurait la gestion et la direction réelle de la discothèque stéphanoise 'Le Whisky Club', dont la propriété du capital était partagée entre M. Lorenzon et sa belle-mère, gérante officielle de cet établissement de nuit".
Par cette activité "contraire aux obligations statutaires et déontologiques" des deux policiers, les requérants ont "porté une grave atteinte au crédit et à la réputation de la police nationale", estime le tribunal. Il rappelle que les fonctionnaires incriminés employaient en outre du personnel non déclaré dans leur discothèque située dans le centre de Saint-Etienne.
Ceci a valu à chacun deux une condamnation pour "travail dissimulé" par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 3 mars 2005 à deux ans de prison avec sursis, 1.500 euros d'amende, une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans et l'interdiction de gérer directement ou indirectement tout établissement nécessitant une licence. AP
December 22, 2005
« Ma Tante » suspectée de blanchiment
« Ma Tante » suspectée de blanchiment Enquête préliminaire contre le Crédit municipal de Paris connu pour ses prêts sur gages. par Tonino SERAFINI Libération, mercredi 21 décembre 2005 Extrait : Ma Tante accusée de légèreté ! De graves soupçons planent en effet sur le Crédit municipal de Paris (CMP), plus connu par le grand public pour son surnom familier et ses prêts sur gages. Vendredi dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire suite à une procédure disciplinaire engagée par la Banque de France. Les faits semblent graves puisque le maire, Bertrand Delanoë, a annoncé le limogeage prochain du directeur général, Luc Matray, nommé à la tête du CMP après l'alternance des municipales de 2001. Tout est parti d'une mission d'inspection menée de septembre à décembre 2004 par la Commission bancaire, le «gendarme» des établissements de crédit. Dans son rapport d'une trentaine de pages (et 500 annexes), la commission pointe des défaillances graves du Crédit municipal en matière de «lutte contre le blanchiment». Il est reproché à ses dirigeants de ne pas avoir transmis à la Tracfin (cellule de lutte contre des opérations de blanchiment de Bercy) des dossiers laissant planer des soupçons. La Commission bancaire pointerait une vingtaine d'opérations, dont sept particulièrement suspectes. |
Le Monde, 20.12.05, l'essentiel :
Le maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS), a rendu publique, lundi 19 décembre, sa décision "d'organiser le départ à court terme" du principal dirigeant du Crédit municipal de Paris, Luc Matray.
M. Matray devait restaurer l'image et la santé d'une maison marquée par des années de dérives financières à l'époque où Jean Tiberi était maire de la capitale.
Or, il affichait, après quatre ans, un bon bilan économique&nbps;: il était parvenu à redresser le Crédit municipal et à réduire le coût des risques pris par une banque qu'il disait "en retard dans l'application des normes réglementaires".
Mardi, des dirigeants du Crédit municipal regrettaient que M. Matray "n'ait pas eu le temps de s'expliquer et de corriger les manquements relevés par la Commission bancaire". Celle-ci avait demandé à la direction de l'établissement de s'expliquer, en janvier.
Selon la mairie de Paris, certains faits reprochés à M. Matray sont antérieurs à son arrivée en 2001. M. Delanoë a demandé à ses services d'"étudier les éventuelles implications pénales de cette procédure disciplinaire, afin que soient défendus les intérêts de la Ville".
Le Crédit Municipal de Paris, héritier du Mont-de-Piété, occupe une place particulière dans le paysage financier français. Banque d'intérêt général à vocation sociale, il accompagne, depuis plus de deux siècles, les mutations économiques et sociales de la Capitale, au service des Parisiens. Fidèle à sa mission, l'établissement a su s'adapter aux besoins d'une clientèle diversifiée et se moderniser. Aujourd'hui, il souhaite s'inscrire dans les problèmatiques d'accès au crédit et aux produits financiers pour favoriser la réalisation de projets socialement utiles. Source : CMP PARIS, 19 déc 2005 (AFP) Le Crédit municipal de Paris (CMP) est sous le coup d'une procédure disciplinaire engagée par la Banque de France, et qui a conduit Bertrand Delanoë à décider le départ de son principal dirigeant, a-t-on appris lundi à la mairie de Paris. Dans un communiqué, l'Hôtel de Ville a choisi de révéler lui-même cette affaire qui, selon d'autres sources parisiennes, pourrait avoir de lourdes implications. Autorité administrative dirigée par le gouverneur de la Banque de France, la Commission Bancaire, "gendarme" de l'activité des établissements de crédit a mené, de septembre à décembre 2004, une mission d'inspection au CMP, a indiqué la mairie. Surnommé "Ma tante", le CMP est un établissement qui dépend à 100% de la collectivité parisienne. Depuis 2004, il a une filiale chargée de ses activités bancaires concurrentielles, la maison-mère gardant l'activité multiséculaire de prêt sur gages. A la suite de la mission d'inspection, la commission bancaire "a décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire", révèle le communiqué. Les faits reprochés "certains antérieurs à mars 2001, concernent la non observation de diverses réglementations" bancaires, ajoute le texte de la mairie. Une formule floue, en raison, explique-t-on, de la confidentialité requise tant que la procédure est en cours. Selon une personne ayant eu accès au dossier, certains faits concerneraient le non signalement de dossiers litigieux aux autorités chargées de lutter contre le blanchiment d'argent. Quels qu'ils soient, ces faits ont conduit le maire PS à décider d'"organiser le départ à court terme de l'ancien directeur général du Crédit municipal, actuellement dirigeant de la filiale du Crédit municipal". Il s'agit de Luc Matray, nommé à la tête du CMP en juin 2001, après l'arrivée de la gauche au pouvoir à la mairie de Paris. Il avait succédé à Guy Legris, imposé par Jean Tiberi contre l'avis de la Commission bancaire qui avait fini par le démettre, un acte exceptionnel. M. Delanoë a aussi demandé de "faire étudier dès maintenant les éventuelles implications pénales de cette procédure disciplinaire". Il entend aussi "accélérer les nombreuses réformes déjà engagées dans le mode de fonctionnement de l'établissement". La Commission bancaire, qui aurait un dossier de plusieurs centaines de pages sur cette affaire, aurait demandé des réponses dès début janvier au CMP. La direction du CMP, pour sa part, souhaiterait un délai jusqu'à fin février pour répondre. |
December 21, 2005
L'affaire Sentier II
L'Expansion, 15.01.02 La Société Générale a riposté mardi à la mise en examen pour «blanchiment aggravé» de son PDG, Daniel Bouton, et de deux autres de ses dirigeants, survenue lundi soir. Ainsi, selon un communiqué diffusé mardi par la banque, «aucun élément du dossier ne laisse supposer qu’un collaborateur ou un service de la banque ait sciemment commis une action de blanchiment». Au sein du staff de la SG, une association regroupant 3500 cadres a exprimé son «incompréhension» et son «indignation» devant ces poursuites judiciaires. Mais au-delà, c’est toute la profession qui fait corps autour de Daniel Bouton. Ainsi, Michel Pébereau, PDG de BNP-Paribas, s’est déclaré certain que ses pairs n’étaient pas coupable. Au centre de l’affaire, en effet, il y a le traitement de certains chèques présentés par des banques étrangères, en majorité israéliennes, pour encaissement auprès de certaines banques française, dont la Société Générale mais aussi la BRED et American Express Bank France. Les établissements français sont accusés de ne pas avoir procédé aux contrôles préalables rendus obligatoires par la loi, et d’avoir de ce fait couvert un circuit de blanchiment d’argent sale. Négligence ou malveillance, ce scandale inquiète les milieux bancaires qui, à l’instar d’Ernest-Antoine Seillière, président du MEDEF, redoutent une excessive pénalisation de leur métier et demandent que la loi précise davantage leurs obligations. François Patriat, Secrétaire d’Etat à la consommation et au commerce, a d’ailleurs abondé mardi en ce sens, assurant qu’il fallait «donner aux banques des directives claires et voir ce qui leur est techniquement possible de faire». |
Libération, no. 7620
SOCIETE, mardi 8 novembre 2005, p. 19
Arrestation du cerveau de l'affaire Sentier II
Philippe Besadoux, que l'on croyait en cavale en Israël, a été incarcéré à Prague.
LECADRE Renaud
Le cerveau présumé de l'affaire Sentier II, Philippe Besadoux, a été incarcéré la semaine dernière en République tchèque. On le pensait en cavale en Israël. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé en mai 2003 par la justice française, il s'est fait arrêter à Prague, sous l'identité de Harry Mervyn, avec dans sa poche un billet d'avion pour Tel-Aviv, selon TV Nova, la chaîne locale.
Sentier II est la suite judiciaire de la première affaire du Sentier (une centaine de commerçants dans le secteur du textile condamnés en 2002 pour fausses traites bancaires). Outre l'élargissement des secteurs d'activité (cuir, intérim, transport...), le nouveau dossier a mis cette fois en cause les banques, comme complices d'un circuit de blanchiment portant sur un milliard de francs : le nom des bénéficiaires de chèques douteux ou volés était modifié en Israël avant de revenir en France au profit de petits malins sachant surfer entre les différentes législations bancaires.
Huit banques (dont la Société générale, la Bred et American Express) sont poursuivies comme personnes morales. Une trentaine de banquiers (dont Daniel Bouton, PDG de la Société générale) sont poursuivis à titre personnel. Mais aussi six rabbins, l'affaire mettant en cause une utilisation dévoyée de la tradition de collecte au sein de la diaspora juive. Pour mieux attirer les dons à vocation caritative, les héritiers du rabbin Elie Rotneimer, fondateur du Refuge, avaient mis en place une nébuleuse associative (centres de formation, maisons de retraite...) par laquelle ont transité 450 millions de francs, une partie des dons (jusqu'à la moitié) étant rétrocédée en liquide, au noir, aux donateurs.
Philippe Besadoux, à la tête de la Compagnie européenne de textile (CET), aurait à lui seul recyclé plus de 100 millions de francs, en trompant la vigilance du Crédit Lyonnais, de la Bred et de La Poste sous une fausse identité.
L'arrestation intervient au moment où la juge d'instruction Xavière Simeoni vient de clôturer son dossier tentaculaire (142 mises en examen au total). Il devrait vraisemblablement être rouvert, après extradition en France de Philippe Besadoux.
Libération, no. 7153
SOCIETE, mercredi 12 mai 2004, p. 15
Sentier: six rabbins qui sentent le soufre
Renvoi devant la cour correctionnelle des religieux français accusés de blanchiment.
LECADRE Renaud
Six rabbins français, dont deux en fuite à l'étranger, sont renvoyés en correctionnelle pour blanchiment. On reproche à ces religieux, de tendance loubavitch, d'avoir dévoyé la tradition de collecte au sein de la communauté juive. Pour appâter les donateurs, des associations réputées caritatives proposaient un retour en liquide pouvant aller jusqu'à 50 % des «rétro-dons», selon l'expression du parquet. Un argument décisif pour draguer certains commerçants adeptes de l'économie au noir. La chambre de l'instruction, qui vient d'examiner pendant deux jours l'affaire du Sentier II (Libération d'hier et d'avant-hier), doit décider si ces rabbins (plus d'une vingtaine de responsables associatifs) seront jugés séparément ou conjointement avec la centaine d'autres mis en examen dans ce dossier tentaculaire.
A l'origine, le rabbin Elie Rotnemer, fondateur du Refuge, organisme collecteur du 1 % logement. Après sa mort en 1994, à la veille d'un scandale financier, ses héritiers ont amplifié et diversifié ses méthodes de collectes au profit d'une nébuleuse de 150 associations (écoles privées, maisons de retraite...) domiciliées en Seine-et-Marne et à Paris dans le XIXe, les deux centres névralgiques des loubavitchs : sur cinq ans (de 1997 à 2001), elles ont brassé 450 millions de francs. La plupart des mis en examen sont des anciens du Refuge. Notamment Joseph Rotnemer, nouveau patriarche familial, et le rabbin Jacques Schvarcz, tous deux en fuite en Israël.
Enveloppes. Le «dévoiement progressif du système associatif fondé à l'origine sur un principe de solidarité communautaire», ainsi qualifié par le parquet, a fait un détour par Mulhouse en 1997, où un réseau profane mis en place par Georges Tuil (en fuite) a le premier utilisé la possibilité d'endosser des chèques en Israël contre remise d'espèces. Comme l'a confessé un de ses lieutenants, «pour faire partir les chèques et récupérer les espèces, il fallait trouver des porteurs». L'idée était de confier les enveloppes à des religieux, peu susceptibles de se faire fouiller à l'aéroport. Joseph Rotnemer ne s'est pas contenté de porter pour Georges Tuil, il a mis en place son propre circuit de blanchiment. Car, au même moment, les donateurs commencent à rechigner. Plusieurs commerçants affirment que des religieux leur ont alors proposé un retour en espèces de plus en plus conséquent. Dont le niveau dépendait par exemple, chez un rabbin, «de ce qu'il avait dans sa mallette».
Un rabbin poursuivi rejette au contraire la faute sur «les vautours des entreprises». Le fils d'un rabbin en fuite met tout le monde d'accord en distinguant les «donateurs casher qu'il faut relancer sans arrêt», des «donateurs pas casher intéressés par les espèces». Le principal collecteur de fonds exagère peut-être quand il assène aux enquêteurs : «Je risque ma vie et celle de ma famille, car celui qui dénonce son prochain est condamné à mort par la communauté. J'arrête de parler.» A l'Essec, qui a fini par rompre tout lien avec la galaxie Rotnemer car l'école de commerce en avait assez de devoir lui rétrocéder 50 % de la taxe d'apprentissage collectée, on assure que le grand rabbin Sitruk serait alors intervenu pour maintenir le flux financier. Interrogé, Sitruk a formellement démenti.
Taxis. L'absence de comptabilité dans ces associations, souvent de simples «taxis», a été source de toutes les combines. En plus des rétro-dons, le parquet estime que près de 30 millions de francs «ont bénéficié à des intérêts privés, dévoyant le caractère non lucratif affiché». Joseph Rotnemer a un jour téléphoné à sa secrétaire en France pour virer des fonds en Hongrie afin de racheter des stations-service...
L'appel à la délation
Qu'on ne vienne pas m'ennuyer parce que je dénonce des faits qui ont porté des préjudices très graves à mes enfants ainsi qu'à ma famille, ceci dans l'intérêts de tiers, au parfait mépris de la morale et de la loi, sous couvert de l'intérêt de l'enfant.Un ministre appelle à la délation et referait tout sauf la police. D'autres en sont à remodeler le dispositif de la protection de l'enfance...
Personne n'y verra donc d'inconvénients si je dénonce et expose les faits au travers de ce site et le recueil d'informations que contient ce blog.
Libération, le 16 décembre 2005 Prévention de la délinquance : Sarkozy refait tout sauf la police Extraits : Un maire tout puissant, des miniprocureurs, une police intouchable, le retour de la loi «anticasseurs», l'appel à la délation... Voilà l'esprit du projet de loi sur la prévention de la délinquance que Nicolas Sarkozy s'apprête à dégainer. Voir deux policiers soupçonnés d'avoir falsifié une procédure « Ma Tante » suspectée de blanchiment Enquête préliminaire contre le Crédit municipal de Paris connu pour ses prêts sur gages. par Tonino SERAFINI Libération, mercredi 21 décembre 2005 Extrait : Ma Tante accusée de légèreté ! De graves soupçons planent en effet sur le Crédit municipal de Paris (CMP), plus connu par le grand public pour son surnom familier et ses prêts sur gages. Vendredi dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire suite à une procédure disciplinaire engagée par la Banque de France. Les faits semblent graves puisque le maire, Bertrand Delanoë, a annoncé le limogeage prochain du directeur général, Luc Matray, nommé à la tête du CMP après l'alternance des municipales de 2001. Tout est parti d'une mission d'inspection menée de septembre à décembre 2004 par la Commission bancaire, le «gendarme» des établissements de crédit. Dans son rapport d'une trentaine de pages (et 500 annexes), la commission pointe des défaillances graves du Crédit municipal en matière de «lutte contre le blanchiment». Il est reproché à ses dirigeants de ne pas avoir transmis à la Tracfin (cellule de lutte contre des opérations de blanchiment de Bercy) des dossiers laissant planer des soupçons. La Commission bancaire pointerait une vingtaine d'opérations, dont sept particulièrement suspectes. |
Le Monde, 20.12.05, l'essentiel :
Le maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS), a rendu publique, lundi 19 décembre, sa décision "d'organiser le départ à court terme" du principal dirigeant du Crédit municipal de Paris, Luc Matray.
M. Matray devait restaurer l'image et la santé d'une maison marquée par des années de dérives financières à l'époque où Jean Tiberi était maire de la capitale.
Or, il affichait, après quatre ans, un bon bilan économique&nbps;: il était parvenu à redresser le Crédit municipal et à réduire le coût des risques pris par une banque qu'il disait "en retard dans l'application des normes réglementaires".
Mardi, des dirigeants du Crédit municipal regrettaient que M. Matray "n'ait pas eu le temps de s'expliquer et de corriger les manquements relevés par la Commission bancaire". Celle-ci avait demandé à la direction de l'établissement de s'expliquer, en janvier.
Selon la mairie de Paris, certains faits reprochés à M. Matray sont antérieurs à son arrivée en 2001. M. Delanoë a demandé à ses services d'"étudier les éventuelles implications pénales de cette procédure disciplinaire, afin que soient défendus les intérêts de la Ville".
Le Crédit Municipal de Paris, héritier du Mont-de-Piété, occupe une place particulière dans le paysage financier français. Banque d'intérêt général à vocation sociale, il accompagne, depuis plus de deux siècles, les mutations économiques et sociales de la Capitale, au service des Parisiens. Fidèle à sa mission, l'établissement a su s'adapter aux besoins d'une clientèle diversifiée et se moderniser. Aujourd'hui, il souhaite s'inscrire dans les problèmatiques d'accès au crédit et aux produits financiers pour favoriser la réalisation de projets socialement utiles. Source : CMP PARIS, 19 déc 2005 (AFP) Le Crédit municipal de Paris (CMP) est sous le coup d'une procédure disciplinaire engagée par la Banque de France, et qui a conduit Bertrand Delanoë à décider le départ de son principal dirigeant, a-t-on appris lundi à la mairie de Paris. Dans un communiqué, l'Hôtel de Ville a choisi de révéler lui-même cette affaire qui, selon d'autres sources parisiennes, pourrait avoir de lourdes implications. Autorité administrative dirigée par le gouverneur de la Banque de France, la Commission Bancaire, "gendarme" de l'activité des établissements de crédit a mené, de septembre à décembre 2004, une mission d'inspection au CMP, a indiqué la mairie. Surnommé "Ma tante", le CMP est un établissement qui dépend à 100% de la collectivité parisienne. Depuis 2004, il a une filiale chargée de ses activités bancaires concurrentielles, la maison-mère gardant l'activité multiséculaire de prêt sur gages. A la suite de la mission d'inspection, la commission bancaire "a décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire", révèle le communiqué. Les faits reprochés "certains antérieurs à mars 2001, concernent la non observation de diverses réglementations" bancaires, ajoute le texte de la mairie. Une formule floue, en raison, explique-t-on, de la confidentialité requise tant que la procédure est en cours. Selon une personne ayant eu accès au dossier, certains faits concerneraient le non signalement de dossiers litigieux aux autorités chargées de lutter contre le blanchiment d'argent. Quels qu'ils soient, ces faits ont conduit le maire PS à décider d'"organiser le départ à court terme de l'ancien directeur général du Crédit municipal, actuellement dirigeant de la filiale du Crédit municipal". Il s'agit de Luc Matray, nommé à la tête du CMP en juin 2001, après l'arrivée de la gauche au pouvoir à la mairie de Paris. Il avait succédé à Guy Legris, imposé par Jean Tiberi contre l'avis de la Commission bancaire qui avait fini par le démettre, un acte exceptionnel. M. Delanoë a aussi demandé de "faire étudier dès maintenant les éventuelles implications pénales de cette procédure disciplinaire". Il entend aussi "accélérer les nombreuses réformes déjà engagées dans le mode de fonctionnement de l'établissement". La Commission bancaire, qui aurait un dossier de plusieurs centaines de pages sur cette affaire, aurait demandé des réponses dès début janvier au CMP. La direction du CMP, pour sa part, souhaiterait un délai jusqu'à fin février pour répondre. Libération, no. 7620 SOCIETE, mardi 8 novembre 2005, p. 19 Arrestation du cerveau de l'affaire Sentier II Philippe Besadoux, que l'on croyait en cavale en Israël, a été incarcéré à Prague. LECADRE Renaud Le cerveau présumé de l'affaire Sentier II, Philippe Besadoux, a été incarcéré la semaine dernière en République tchèque. On le pensait en cavale en Israël. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé en mai 2003 par la justice française, il s'est fait arrêter à Prague, sous l'identité de Harry Mervyn, avec dans sa poche un billet d'avion pour Tel-Aviv, selon TV Nova, la chaîne locale. Sentier II est la suite judiciaire de la première affaire du Sentier (une centaine de commerçants dans le secteur du textile condamnés en 2002 pour fausses traites bancaires). Outre l'élargissement des secteurs d'activité (cuir, intérim, transport...), le nouveau dossier a mis cette fois en cause les banques, comme complices d'un circuit de blanchiment portant sur un milliard de francs : le nom des bénéficiaires de chèques douteux ou volés était modifié en Israël avant de revenir en France au profit de petits malins sachant surfer entre les différentes législations bancaires. Huit banques (dont la Société générale, la Bred et American Express) sont poursuivies comme personnes morales. Une trentaine de banquiers (dont Daniel Bouton, PDG de la Société générale) sont poursuivis à titre personnel. Mais aussi six rabbins, l'affaire mettant en cause une utilisation dévoyée de la tradition de collecte au sein de la diaspora juive. Pour mieux attirer les dons à vocation caritative, les héritiers du rabbin Elie Rotneimer, fondateur du Refuge, avaient mis en place une nébuleuse associative (centres de formation, maisons de retraite...) par laquelle ont transité 450 millions de francs, une partie des dons (jusqu'à la moitié) étant rétrocédée en liquide, au noir, aux donateurs. Philippe Besadoux, à la tête de la Compagnie européenne de textile (CET), aurait à lui seul recyclé plus de 100 millions de francs, en trompant la vigilance du Crédit Lyonnais, de la Bred et de La Poste sous une fausse identité. L'arrestation intervient au moment où la juge d'instruction Xavière Simeoni vient de clôturer son dossier tentaculaire (142 mises en examen au total). Il devrait vraisemblablement être rouvert, après extradition en France de Philippe Besadoux. Libération, no. 7153 SOCIETE, mercredi 12 mai 2004, p. 15 Sentier: six rabbins qui sentent le soufre Renvoi devant la cour correctionnelle des religieux français accusés de blanchiment. LECADRE Renaud Six rabbins français, dont deux en fuite à l'étranger, sont renvoyés en correctionnelle pour blanchiment. On reproche à ces religieux, de tendance loubavitch, d'avoir dévoyé la tradition de collecte au sein de la communauté juive. Pour appâter les donateurs, des associations réputées caritatives proposaient un retour en liquide pouvant aller jusqu'à 50 % des «rétro-dons», selon l'expression du parquet. Un argument décisif pour draguer certains commerçants adeptes de l'économie au noir. La chambre de l'instruction, qui vient d'examiner pendant deux jours l'affaire du Sentier II (Libération d'hier et d'avant-hier), doit décider si ces rabbins (plus d'une vingtaine de responsables associatifs) seront jugés séparément ou conjointement avec la centaine d'autres mis en examen dans ce dossier tentaculaire. A l'origine, le rabbin Elie Rotnemer, fondateur du Refuge, organisme collecteur du 1 % logement. Après sa mort en 1994, à la veille d'un scandale financier, ses héritiers ont amplifié et diversifié ses méthodes de collectes au profit d'une nébuleuse de 150 associations (écoles privées, maisons de retraite...) domiciliées en Seine-et-Marne et à Paris dans le XIXe, les deux centres névralgiques des loubavitchs : sur cinq ans (de 1997 à 2001), elles ont brassé 450 millions de francs. La plupart des mis en examen sont des anciens du Refuge. Notamment Joseph Rotnemer, nouveau patriarche familial, et le rabbin Jacques Schvarcz, tous deux en fuite en Israël. Enveloppes. Le «dévoiement progressif du système associatif fondé à l'origine sur un principe de solidarité communautaire», ainsi qualifié par le parquet, a fait un détour par Mulhouse en 1997, où un réseau profane mis en place par Georges Tuil (en fuite) a le premier utilisé la possibilité d'endosser des chèques en Israël contre remise d'espèces. Comme l'a confessé un de ses lieutenants, «pour faire partir les chèques et récupérer les espèces, il fallait trouver des porteurs». L'idée était de confier les enveloppes à des religieux, peu susceptibles de se faire fouiller à l'aéroport. Joseph Rotnemer ne s'est pas contenté de porter pour Georges Tuil, il a mis en place son propre circuit de blanchiment. Car, au même moment, les donateurs commencent à rechigner. Plusieurs commerçants affirment que des religieux leur ont alors proposé un retour en espèces de plus en plus conséquent. Dont le niveau dépendait par exemple, chez un rabbin, «de ce qu'il avait dans sa mallette». Un rabbin poursuivi rejette au contraire la faute sur «les vautours des entreprises». Le fils d'un rabbin en fuite met tout le monde d'accord en distinguant les «donateurs casher qu'il faut relancer sans arrêt», des «donateurs pas casher intéressés par les espèces». Le principal collecteur de fonds exagère peut-être quand il assène aux enquêteurs : «Je risque ma vie et celle de ma famille, car celui qui dénonce son prochain est condamné à mort par la communauté. J'arrête de parler.» A l'Essec, qui a fini par rompre tout lien avec la galaxie Rotnemer car l'école de commerce en avait assez de devoir lui rétrocéder 50 % de la taxe d'apprentissage collectée, on assure que le grand rabbin Sitruk serait alors intervenu pour maintenir le flux financier. Interrogé, Sitruk a formellement démenti. Taxis. L'absence de comptabilité dans ces associations, souvent de simples «taxis», a été source de toutes les combines. En plus des rétro-dons, le parquet estime que près de 30 millions de francs «ont bénéficié à des intérêts privés, dévoyant le caractère non lucratif affiché». Joseph Rotnemer a un jour téléphoné à sa secrétaire en France pour virer des fonds en Hongrie afin de racheter des stations-service... |
December 15, 2005
Délit de favoritisme
Quand on parle de délit de favoritisme, on pense aux relations quelquefois ambiguës que peuvent entretenir certaines administrations avec certaines entreprises privées. Or, aujourd'hui, l'élément matériel qui constitue le délit de favoritisme se trouve plus souvent entre deux personnes publiques qu'entre une personne publique et une personne privée !Article du numéro 306 - 15 Novembre 2005
La lettre du cadre territorial
Voir aussi l'article n°147 de l'Observatoire (des risques juridiques) des collectivités territoriales... Dans un article de la Lettre du cadre territorial (n°306 du 15 novembre 2005), Patrice Cossalter et Walter Salamand, avocats au barreau de Lyon, relèvent que le délit de favoritisme peut aussi concerner les relations contractuelles entre collectivités publiques |
December 14, 2005
L'émergence des droits de l'homme en Europe
Détenus battus, rapport disparu, procès suspendu Libération, mardi 13 décembre 2005 par Olivier BERTRAND Le tribunal correctionnel de Chambéry (Savoie) devait juger hier un directeur de prison et un surveillant accusés d'avoir frappé deux détenus de 17 ans, en juillet 2003, avant de les enfermer, nus et attachés, dans une cellule disciplinaire. Le parquet avait d'abord classé ce dossier, mais l'Observatoire international des prisons l'a exhumé après avoir reçu le témoignage de personnels. L'inspection des services pénitentiaires a donc rédigé un rapport, directeur et surveillant ont été renvoyés devant le tribunal, mais le procureur a refusé de produire la pièce principale : le rapport administratif. Les avocats des jeunes détenus s'en sont plaints : le tribunal a renvoyé l'affaire au 13 mars, ordonnant au procureur «la communication de toutes les pièces». |
Ce n'est qu'en Europe que les droits de l'homme émergent alors que les frontières de la France sont réputées imperméables (se souvenir de Tchernobyl).
Chez aidh.org je relève 1763, Diderot, un plaidoyer pour le droit d'écrire et de publier :
« Citez-moi, je vous prie, un de ces ouvrages dangereux, proscrits, qui, imprimé clandestinement chez l'étranger ou dans le royaume, n'ait été en moins de quatre mois aussi commun qu'un livre privilégié [bénéficiant d'une autorisation de publier liée à une approbation]? Quel livre plus contraire aux bonnes murs, à la religion, aux idées reçues de philosophie et d'administration, en un mot à tous les préjugés vulgaires, et par conséquent plus dangereux que les Lettres persanes? que nous reste-t-il à faire de pis? Cependant, il y a cent éditions des Lettres persanes et il n'y a pas un écolier du collège des Quatre-Nations [riche collège parisien] qui n'en trouve un exemplaire pour ses douze sous... » |
L'Observatoire international des prisons rappelle pour sa part que...
« tout enfant privé de liberté [doit] être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine » (art. 37 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant).
« nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » (art. 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).
etc, etc...
Paris, le 19 octobre 2004 La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a recueilli de nombreux témoignages concordants qui relatent des incidents graves survenus le dimanche 6 juillet 2003 à la maison d’arrêt de Chambéry (Savoie). Ces témoignages font notamment état de l’usage de fusils « riot-gun » au quartier des mineurs et d’actes de violences commis par des personnels pénitentiaires à l’encontre de détenus mineurs. Le dimanche 6 juillet 2003, vers 14h15, plusieurs surveillants procèdent à l’ouverture pour l’après-midi des portes du quartier « mineurs ». Le détenu S., 17 ans, sort torse nu dans le couloir. Malgré une température exceptionnellement élevée, un surveillant lui demande de revêtir un T-Shirt. Monsieur S. refuse et l’insulte. Le surveillant lui ordonne de retourner dans sa cellule mais essuie un nouveau refus. Il s’ensuit une empoignade entre le détenu et deux surveillants. Un autre détenu mineur, Monsieur T., sort de sa cellule voisine et se mêle à l’incident. Il est maîtrisé par les surveillants et replacé dans sa cellule où, selon un témoignage, il est agressé par un surveillant. Ce dernier est raisonné par ses collègues puis écarté de la zone de détention des mineurs. (.../...) |
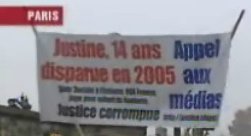
"Nous savons tous qu'afin d'influencer l'issue des matches on propose de l'argent ou autre chose aux directeurs de jeu. Ils peuvent l'accepter", a dit Fanny Amun.
"Ils doivent seulement faire semblant de mordre à l'hameçon, et s'assurer que le résultat ne favorise pas ceux qui ont offert le pot-de-vin", a-t-il ajouté.